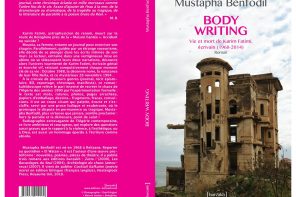Maïssa Bey est autrice d’un corpus conséquent de textes de roman, d’essai, de nouvelles, de poésie et de théâtre. En août dernier, son roman Nulle autre voix a été publié aux éditions Barzakh en Algérie, et aux éditions de l’Aube en France. Il y est question d’une femme qui tue un homme, son mari. Rencontre.
Onorient : Maïssa Bey, vous êtes née à Ksar El Boukhari en 1950, dans le contexte de la colonisation de la France en Algérie. Votre père était instituteur. Fermement engagé pour l’indépendance de l’Algérie, il était convaincu qu’un homme instruit ne pouvait être colonisé. Il payera tragiquement son engagement de sa vie…Comment était-ce de grandir, sans un père, en Algérie ?
Vivre dans une famille amputée du père dans une société encore très rattachée aux traditions, ce n’était pas facile. Je pense aux veuves, aux divorcées et à toutes les personnes qui ne bénéficient pas de caution masculine. Ma mère était une femme très courageuse et instruite. Son objectif principal était que nous continuions nos études : mon père lui avait fait promettre. Elle ne parlait pas de ses propres sentiments. Mais une famille sans homme est un manquement aux yeux de la société, et elle n’avait pas le droit à la même considération que les femmes mariées dans la société algérienne.
La figure de la mère revient souvent dans vos romans. Dans Nulle autre Voix, et dans Hizya, par exemple, les mères sont garantes de la réputation de leurs filles. Elles sont dures, parfois injustes.
Tout à fait. Elle sont marquées par un discours patriarcal qu’on leur a inculqué et qu’elles pérennisent. Les traditions sont mêlées à la religion. On ne leur a pas laissé d’autres choix que d’être les gardiennes de la pureté et de la virginité par exemple, conditions sine qua none de l’honneur d’une famille. Ces femmes que j’ai imaginées dans mes romans et que j’ai pu côtoyer dans la vie, sont incapables de prendre du recul, en raison d’un manque d’outils intellectuels. La pression sociale finalement inhibe les rapports Mère-Fille. Je me bats contre cela. Quand on met au monde des enfants, leur bonheur est prioritaire. Les mères ne doivent pas sacraliser le mariage et la pureté, au détriment de tout mouvement de libération et de bonheur de leurs filles.
Vos écrits ont d’abord été des écrits intimes. Les masques tombent, et il n’y est plus question de répondre aux attentes de la société. Vous y trouvez la liberté et l’espace d’y exprimer vos révoltes face aux injustices et aux peines qui vous entourent. Comment passe-t-on d’une écriture pour soi à une écriture pour l’autre ?
C’est un passage très difficile. On est tellement habitué.e.s à réfréner ses pulsions et à vivre dans le silence et dans le confinement pour beaucoup ! Passer d’un personnage social, parfaitement adapté à une société, qui ne supporte ni les ruades ni les écarts, à un personnage public qui dit les choses comme il les sent, c’est une transgression. Finalement, il s’agit d’un passage à une forme de liberté : celle de dire, sans frein et sans censure. C’est cette liberté qui m’a donné le goût de l’écriture.
Vous vous autorisez cela, sous un pseudonyme, pour vous protéger d’un terrorisme qui ciblait entre autre les intellectuels. Avec votre mère, vous choisissez celui de Maïssa Bey. Il s’agit pour vous d’une deuxième naissance. Cette fois, cependant, vous naissez libre d’être celle que vous voulez être.
II y a eu, en effet, une sorte de dédoublement. J’étais Maïssa en tant que personnage public et dans ma vie familiale, je restai Samia. Ce dédoublement m’a beaucoup aidé. Je me suis sentie protégée, et encouragée à aller de plus en plus loin. Il y avait une autre personne qui pouvait dire les choses comme elle avait envie de le dire, affranchie des attentes et des conditionnements.
Vous avez commencé à être publiée à l’âge de 47 ans. Un âge qui peut-être considéré comme tardif pour certains, mais pas tant que ça finalement. Vous vous êtes mariée à 20 ans, vous avez eu votre premier enfant à 21 ans, suivis de trois autres enfants. Il fallait entretenir tout ce beau monde, cuisiner, recevoir, aider aux devoirs. En parallèle pourtant, et vous y teniez, vous avez continué à enseigner le français au lycée. Finalement, à 47 ans, vos enfants sont plus ou moins indépendants. Vous avez à nouveau du temps pour vous, et vous questionnez le sens de votre vie, en pleine décennie noire. Pourquoi vous-êtes vous autorisée ce questionnement personnel si tard dans votre vie, et en pleine guerre civile ?
Dans le contexte des années noires du terrorisme, je me suis sentie enfermée, bridée, encore plus qu’avant. Les femmes et les hommes étaient condamnés au silence. Voir toutes ces voix qui s’étaient tues ou qu’on avait fait taire, me poussait à la création. J’avais envie d’inventer des vies et des possibles, alors que nous étions nous-mêmes privés de toute forme de créativité. En parallèle, les enfants avaient grandi, et n’avaient plus besoin de ma présence constante. Je me suis demandée : qu’est ce que j’ai fait de ma vie ? Des enfants et un métier que j’ai adoré. Mais ça ne me suffisait plus. Étant grande lectrice, j’avais toujours vécu avec les mots des autres, sans m’y retrouver complètement. C’est là que m’est venue l’idée de mon premier roman. Comme un défi lancé à moi-même.
Selon vous, la situation des femmes régresse en Algérie.
Ces dernières années, beaucoup d’interdits ont été réactivés. Ils brident les élans et les aspirations des femmes. Vous êtes scrutées, avant même de prendre la parole. Il y a une volonté de tout savoir sur l’autre, mêlé à du jugement, aux traditions, aux interdits, et à tout ce qui constitue les ossatures de la société. Dans les années 1970, on se sentait beaucoup plus libres et libérées. En même temps, il y a un élan de jeunes qui s’affirment. Elles foncent et enfoncent les portes, et là les parents n’y peuvent rien, ou alors, ils aident. D’autres, attendent confites et très soumises le mari qui va venir et qui va déterminer tout le reste de leur vie.
Vos écrits ont-ils permis d’engager des discussions au sujet des injustices vécues par les femmes, dans l’espace public et dans l’espace privé ?
Quand je fais des rencontres, on me pose des questions sur ma parole qui ne prend pas de détour. Beaucoup de femmes m’en sont reconnaissantes, mais elles sont aussi gênées par ce que je dévoile. Dans notre société, on ne parle pas du désir et du corps des femmes. Dans Nulle autre voix, quand je parle du visible et du caché, le personnage a bien envie de dire les choses mais elle ne va pas transgresser les frontières qu’elle s’est elle-même fixée…La libération de la parole est en enjeu. Des femmes m’ont également transmis des carnets, retraçant leurs vies… Devenir le réceptacle des silences imposés, c’est très fort pour moi.
Avez-vous des modèles féminins auxquels vous vous référez dans vos instants de doute ?
Dans la vie quotidienne, il y a des femmes qui forcent l’admiration. Des femmes qui ont pu et qui ont su dire non, au détriment de leur projet de vie. Par ailleurs, Assia Djebar a beaucoup compté pour moi, en tant qu’écrivaine et en tant que femme qui parlait véritablement des femmes. Je l’ai découverte très jeune et elle m’a ouvert les chemins de l’écriture.
Des livres à conseiller ?
J’en ai lu des dizaines après l’écriture de Nulle autre voix pour rattraper mon retard. En ce moment, je lis La servante écarlate de Margaret Atwood. Cette histoire, comme des couches de peintures travaillées aux couteaux, est fabriquée avec des détails qui vous immergent dans les mondes qu’elle crée. J’ai trouvé également très intéressant L’art de perdre d’Alice Zeniter et La vérité sort de la bouche du cheval de Meryem Alaoui.