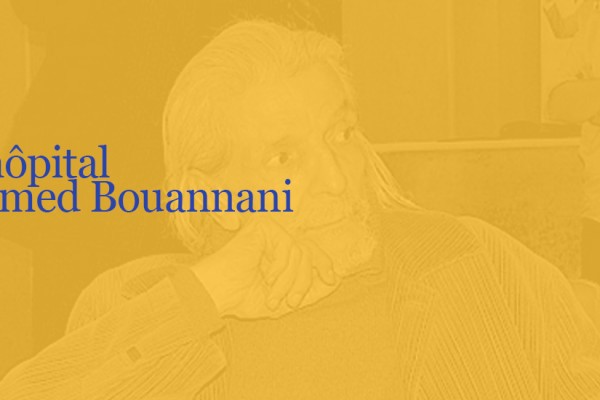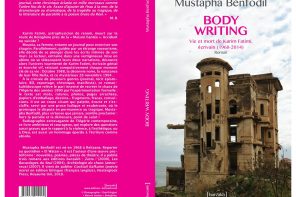Fin 2012, c’est un roman salué par la critique qui fait son entrée dans les librairies françaises, L’Hôpital. Livre qui appartient à un homme qui nous a quitté en Février 2011 et qu’on connaissait pour être cinéaste. Depuis le début de l’année, le roman est maintenant disponible dans une édition marocaine (Dk Editions). ONORIENT vous fait découvrir le livre de l’étrange et atypique Ahmed Bouanani.
Étrange et atypique, Ahmed Bouanani l’était certainement. Il avait su pendant de longues années garder ses distances des projecteurs alors même qu’il ne cessait de produire de véritables bijoux cinématographiques, dont notamment Mirage. D’ailleurs, il était reconnu pour cela, un cinéaste de talent qui était entrain se positionner parmi les pionniers de cet art au Maroc. Un temps cinéaste, un autre temps poète avec à son actif trois recueils de poésie publiés, aujourd’hui on le découvre romancier avec son livre L’Hôpital.
Aujourd’hui, mon nom est un numéro, j’occupe le lit n°17 dans le pavillon C, je suis en pyjama bleu fripé parmi d’autres pyjamas bleus fripés, membre d’une fratrie mélancolique et joyeuse, qui ne se pose plus de questions depuis longtemps. Je ne me confesse pas, et je n’ai aucune prétention de décrire ce que je ne sais pas.
L’Hôpital se situe à mi-chemin entre la fiction et la pure autobiographie, d’ailleurs l’auteur du récit avait écrit ce présent livre lors d’un séjour à l’hôpital. Dans le récit et de la plume d’un pensionnaire d’un hôpital psychiatrique qui consigne les faits, gestes et pensées, on découvre un espace enfermé où un groupe de pensionnaires aux trajectoires différentes persistent à animer leur petit quotidien lugubre, en dépit du malheur d’être livrés à eux-mêmes. Les pensionnaires ont tous des noms fictifs, allant de Le Litron à O.K, passant par Argane, Le Corsaire ou encore Le Pet. Tous sont plus ou moins atteints psychiquement, ont un problème, un vice mais aussi un côté humain et rêveur. C’est d’ailleurs ces deux côtés que le narrateur explore avec tact et précision. Dans ses confessions consignées, on sent aussi une vaine volonté de ne pas devenir comme eux, de ne pas perdre contact avec le monde extérieur pour voir sa vie résumer à cet espace déshumanisé. Cela est on ne peut plus ressenti dans ce qu’il écrit : « je suis comme un cheval sauvage prisonnier dans un corps serein où la vie bat malgré la peur, malgré la menace d’être un jour dilué comme un vulgaire soluté dans l’atmosphère meurtrière de l’hôpital ». Pour contrer cette peur, le narrateur va jusqu’à se remémorer quelques souvenirs d’enfance, ultime moyen pour garder le contact avec la vie, sa sienne et la vraie. Un moyen qu’on pourrait regretter car l’on pourrait considérer ceci comme une manière de songer avec nostalgie au corps d’avant et de pleurer celui du présent qui souffre et l’amène à vivre ces pénibles quotidiens. Cela étant, malgré cette peur et cette menace, le narrateur garde un espoir. Car au contraire des autres, lui au moins, pourra sortir un de ces jours. Son état est particulier et son séjour n’est pas définitif.
Au côté des personnages, il y a de marquant cet espace-temps singulier et indéfini que l’auteur a su construire. L’endroit qu’est l’hôpital tend à ressembler à un monde parallèle où feignent de vivre quelques dernières âmes. Le récit frôle de ce fait le fantastique. Tout est flou, rien n’est sûr ni clair. On ne sait pas où est le personnel de l’hôpital ni où se trouve exactement la porte, et encore moins combien il y a de pensionnaires. On ne sait pas quel jour on est, une notion du temps que probablement les internes de l’hôpital ont perdue depuis longtemps du fait de la monotonie des jours. On ne sait rien. A peine sait-on que tous les pensionnaires sont condamnés, qu’ici ils ne peuvent qu’attendre la mort, rire ou blaguer par moments, et rêver de ce beau matin où ils ne se réveilleront pas. D’ailleurs, dans sa postface du livre, Mohammed Berrada a raison de qualifier l’hôpital d’un lieu qui n’est plus refuge pour l’individu ou un remède contre une maladie particulière, mais plutôt d’un lieu de rencontre de tous et d’exposition de tous les maux. Il devient alors inéluctable de ne pas comparer cet hôpital et ce que vivent ses pensionnaires à la vie d’une large couche de la société marocaine, vivant aux bords de la société, et n’ayant cure de ce qui se passe dans le vrai monde car ce qui les préoccupe c’est leur misérable petite vie dont ils savent la fin prochaine, quoiqu’ils puissent faire. Une fin qui pourrait mettre un terme à ce désordre flouté.
Quoiqu’il en soit, Ahmed Bouanani nous aura laissé une belle œuvre et aura aussi réussi son pari. Parler d’eux, ces pensionnaires et faire comme l’avait suggéré ce curieux personnage du nom de Le Litron au narrateur : « Tu n’es pas analphabète, toi, un jour peut-être, tu pondras un livre où il sera question de nous, de nos testicules, de la belle merde où nous croupissons jusqu’aux oreilles ! […] ponds-le, pour le plaisir, pour faire chier le monde de la cravate et de l’hypocrisie ! »