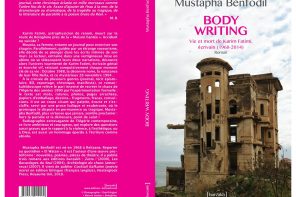Outre le conflit continu depuis plus de soixante ans au Moyen-Orient, l’écrivain qui vit dans cette région du monde et qui s’exprime en langue arabe doit faire face à des réalités des plus défavorables.
À commencer par l’analphabétisme. Sur les quatre cent millions d’habitants que compte le monde arabe, environ le tiers est analphabète. C’est l’un des taux les plus élevés au monde. Ensuite, vient le fait que dans ces contrées on ne lit pas. Selon les statistiques publiées par la Fondation de la pensée arabe sur le développement culturel, le taux moyen de lecture annuelle pour un enfant arabe est de six minutes seulement, quand celle de l’adulte ne dépasse pas dix minutes. À l’échelle mondiale, c’est l’un des taux les plus faibles.
La situation s’est aggravée encore plus avec les conflits armés qui ravagent le monde arabe depuis cinq ans. L’Irak, le Yémen, la Libye, la Syrie… c’est une tragédie pour une génération d’enfants dont les chances d’avoir une instruction même limitée ont disparu. Selon un rapport de l’UNICEF publié en 2014, environ 5.5 millions d’enfants syriens sont quasiment privés d’enseignement – ils ont été déplacés dans leur propre pays, réfugiés dans des pays voisins, ou se sont retrouvés piégés dans des zones assiégées et leurs écoles ont arrêté de fonctionner.
La censure due à l’oppression politico-religieuse est un obstacle de taille pour les écrivains arabes. En Egypte, le Prix Nobel de littérature Néguib Mahfouz a été poignardé et un livre comme Les Mille Et Une Nuits a été interdit et brûlé.
Pour autant, on écrit. Beaucoup. Et chose remarquable : comme jamais auparavant en Occident, on traduit et on publie des œuvres d’origine arabe assurant à leurs auteurs une écoute certaine. Farouk Mardam Bey, éditeur de la collection Sindbad chez Actes Sud, affirme que l’ensemble des œuvres traduites de l’arabe et publiées en France depuis la Seconde guerre mondiale, rend tout à fait compte des courants majeurs de cette littérature.
De plus, il est frappant de constater à cet égard que nombre d’écrivains arabes dont le français est la langue d’expression occupent désormais une place considérable sur la scène littéraire française. Citons Tahar Ben Jelloun et Amin Maalouf qui ont tous deux reçu le Prix Goncourt. D’ailleurs, ce dernier et la regrettée l’écrivaine algérienne Assia Djebar ont été élus à l’Académie française. Citons aussi l’Égyptien Alaa El-Aswany qui a connu un succès retentissant en France avec L’Immeuble Yacoubian, roman miroir de la réalité politique et sociale de son pays ; Samar Yazbek et ses écrits sur la Syrie. Il y a aussi Adonis, et Mahmoud Darwish qui a donné un formidable écho à la cause palestinienne.
Cette relation intime entre guerre et écriture semble susciter un énorme intérêt chez les éditeurs français et par conséquent chez les lecteurs. Aujourd’hui par exemple, il y a un intérêt manifeste pour les littératures syriennes et irakiennes issues de la guerre, comme pour la guerre civile libanaise et ses conséquences qui constituaient la clé de voûte des romans de plusieurs écrivains libanais.
Nombreux sont les écrivains libanais contemporains en langue française dont l’expression littéraire est née de la violence engendrée par des années de guerre (Etel Adnan, Vénus-Khoury Ghata, Amin Maalouf, Salah Stétié et j’en passe…). Certains d’entre eux racontent leur vie en prose et en poésie dans un français métissé d’arabe. Ils naviguent entre deux cultures et deux langues comme s’ils se déplacent entre deux chambres d’une seule et même maison. Il y a aussi une littérature d’exil qui se manifeste chez Wajdi Mouawad, qui, par son théâtre cathartique et son œuvre romanesque, ne cesse de dire la guerre allant jusqu’à affirmer qu’ »il est cette guerre ».
Pour ma part, je participe à cette vision. Mes œuvres littéraires je les écris en langue arabe et elles sont traduites en français, ainsi que dans d’autres langues. Pour moi, écrire reflète un attachement profond à la vie, mais c’est l’attachement des noyés qui se débattent. Personnellement, je n’ai pas vraiment connu la guerre civile du Liban. Mes parents m’ont envoyé au Venezuela au tout début du conflit, croyant que ce serait pour deux semaines, le temps que ça se calme – le conflit a duré quinze ans ! De Caracas, je suis venu à Paris pour y poursuivre mes études et j’ai décidé d’y rester. Même de loin, la guerre me façonne.
Face au déferlement de violence qui se répand partout autour de nous, je sens encore plus fort la nécessité d’écrire et de témoigner ; de braver cette violence en utilisant un autre langage que la sienne. Ainsi je voyage avec les mots et à travers eux, ces compagnons sans frontières. Dans la solitude et le silence qu’exige la feuille blanche, je les regarde venir l’un après l’autre. Chaque mot prend sa place. Avant le sens, c’est une forme, comme une terre lointaine qui brille après un long voyage.