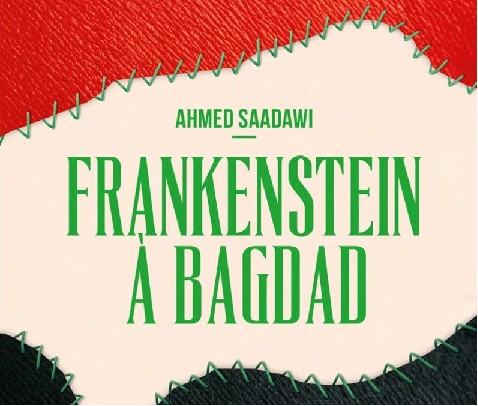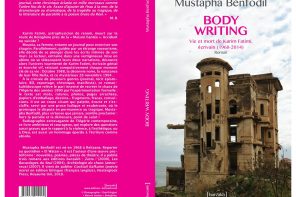Ahmed Saadawi a reçu le Prix international du roman arabe en 2014 pour son roman Frankenstein à Bagdad. Oscillant entre réalité sordide du chaos irakien et conte fantastique, le récit se situe dans l’Irak de l’après Saddam Hussein.
Comme le Frankenstein créé par l’anglaise Mary Shelley, le Frankenstein irakien échappe à son créateur, Hadi, pour aller venger les multiples âmes irakiennes victimes de l’injustice. Construit autour de récits enchâssés mêlant le réel et l’imaginaire, Frankenstein à Bagdad revient sur le chaos qui ne quitte plus l’actualité de l’Irak et de sa capitale, Bagdad.
Ô Bagdad…
Bagdad. An 2003. La capitale irakienne est mise à sac par l’invasion américaine. Deux ans plus tard, la ville poursuit sa chute dans l’escarcelle de la violence et des attentats meurtriers. L’année 2005, période où a lieu le récit, reste marquée par l’exacerbation des tensions communautaires et les combats entre l’occupant américain et la résistance armée qui se déploie sur le sol irakien. Les irakiens assistent alors impuissants à un paroxysme de violence phénoménale qui débouche sur une atmosphère eschatologique. Comme elles ont rythmé le quotidien des Bagdadiens, les explosions vont rythmer le roman. La rue Al-Rashid comme l’hôpital Al-Kindi, tous ces lieux qui renvoient à des noms glorieux hérités de l’histoire riche de la ville, ne sont plus que des repères pour savoir où s’est produit tel attentat à la voiture piégée.
L’évolution du vieux quartier populaire et multiconfessionnel de Batawin, où se déroule le roman, symbolise la déchéance de la vie sociale. Considéré comme l’un des endroits les plus prisés de la capitale au début du XXème siècle, la fréquentation du quartier s’est dégradée jusqu’à devenir, à partir des années 1990, le lieu où se retrouvent prostitués, vendeurs d’alcool fait maison, gangs de kidnappeurs et trafiquants en tous genres.
Quelques modestes familles vivent encore dans le quartier comme Oum Daniel[1], Elishua de son prénom, qui est harcelée par les agents immobiliers qui souhaitent récupérée sa belle et ancienne maison. Oum Daniel, comme Oum Salim et d’autres mères irakiennes, de toutes confessions confondues, continuent de vivre en portant le deuil et le nom du fils perdu. Ahmed Saadawi entend faire témoigner ces mémoires douloureuses de l’Irak moderne. Le lecteur est invité à se souvenir de tous les Daniel et Salim, cette jeune génération d’irakiens que le pouvoir a sacrifié sur le front mortel irano-irakien.
D’ailleurs, à quelques pas de là, se trouve Abou Zaydoun, le barbier, celui qui a traqué, quelques décennies auparavant, les jeunes gens pour les envoyer mourir dans ce carnage de million de morts.
« Le nouvel Irak »
Chacun essaie de « servir le nouvel Irak » à sa manière, cet Irak qui était sensé goûté aux plaisirs illimités et jouissifs de la sainte Démocratie et de sa consœur la Liberté. Mahmoud al-Sawadi, jeune journaliste, est obnubilé par la fastueuse vie que mène son patron qui jongle entre voyages, amantes et connivence avec les hautes sphères du pouvoir.
Cloîtré dans son bureau de la brigade de Surveillance et d’Intervention, le brigadier Sourour tente tant bien que mal d’« anticiper » le chaos grâce aux astrologues recrutés. Les astrologues ont toujours eu pignon sur rue en Irak. Il fut un temps où l’Etat irakien les faisait profiter du confort des geôles irakiennes. Toujours est-il que l’ensemble de la société irakienne se cramponne aux pouvoirs des astrologues alors que la capitale continue à s’embraser.
La défaillance du politique bouleverse toute la société, et la situation de chaque personnage en devient le reflet. Ceux qui étaient puissants hier sont devenus faibles aujourd’hui et vice versa.
De la banalité de l’injustice
La valeur de l’être humain en Irak est devenue insignifiante. Certaines scènes montrent à quel point l’injustice est devenue banale. Les citoyens sont à la merci du premier truand ou d’une quelconque milice. Le policier qui torture le chiffonnier ne sait même plus pour quelle raison il le fait. La dignité est clairement abolie et la subversion est à son comble. La terreur se dilue dans les rues de Bagdad et toute la ville vit avec la peur de mourir. Les irakiens semblent avoir renoncé à toutes certitudes sauf à celle de croire que la mort peut les gober à tout instant.
Ahmed Saadawi redessine avec justesse les impressions que le pays a laissées à ses habitants ces dernières années. Certains lecteurs irakiens n’ont d’ailleurs pas pu terminer le roman. Beaucoup ont reconnu le talent du romancier. Mais leur quotidien s’est imprégné d’une violence telle que même la fiction se trouve incapable de dépasser.
L’injustice a fini par ensemencer un pays qui n’attendait que d’enfanter la vengeance des innocents. C’est ainsi que Hadi Al Attag, le chiffonier du quartier, à l’instar du Doctor Victor Frankenstein, crée « Celui qui n’a pas de nom ». Le Trucmuche prend vie grâce aux lambeaux de cadavres ramassés par Hadi après telle ou telle explosion. Ce sont toutes les victimes d’attentats qui sont réunies dans un corps et qui crient vengeance.
Le fait que Trucmuche prenne vie à cette période permet de comprendre pourquoi la situation politique en Irak, contrairement à ce que laisse penser la médiatisation actuelle des événements, avait déjà atteint un niveau de violence exceptionnel ! Ces faits sonnent presque comme un prélude à Daech. En Irak, et ce depuis longtemps, la pulsion de mort est alimentée de toutes parts. La spirale de la peur se multiplie à l’infini, c’est une peur générée par la mort, et qui génère elle-même la mort.
Une mosaïque de culture brisée
A l’image de Bagdad, et de l’Irak en général, le quartier de Batawin, perd de plus en plus, et nous le remarquons au fil du roman, son caractère multiconfessionnel. Les juifs irakiens ayant déjà quitté l’Irak depuis plus d’un demi-siècle, il subsistait encore les deux religions monothéistes. Or, l’absence de sécurité a fini par pousser au départ les quelques familles chrétiennes restantes.
D’ailleurs, l’exil des chrétiens d’Irak ne semblent pas poser des problèmes de conscience aux hommes politiques et aux milices en Irak. Le lecteur pourrait conclure qu’il ne reste plus qu’une religion monothéiste. Mais on peut affirmer aisément, comme l’atteste le roman, que même l’islam a été pris en otage par le pharisaïsme religieux. La terre d’Abraham n’est plus.
Oum Daniel, comme Wardiya, le personnage principal d’Inaam Kachachi dans Dispersés, refuse d’ailleurs de quitter sa terre natale bien qu’elle soit séparée de sa famille. Cette dame âgée comme ses coreligionnaires représentaient une partie de l’Irak. Leur exil marque la perte irremplaçable d’une riche partie de l’identité irakienne. Les chrétiens d’Irak avaient d’ailleurs marqué, le 31 octobre 2016, le 6e anniversaire de l’attaque terroriste de la cathédrale syrienne catholique de Bagdad, Sayidat al Najat, qui avait fait une cinquantaine de victimes, provoquant un choc au sein de la population.
La désintégration se poursuit sous l’œil de Trucmuche que les pouvoirs publics ne semblent pas pouvoir appréhender. Restent la mémoire et la trace indélébile des souvenirs que les uns et les autres auront partagé. A Batawin, une riche diversité de cultures et d’ethnies a existé. Cette trace de vie, aucune bombe ne pourra l’effacer.
[1] Oum Daniel signifie la mère de Daniel, comme l’usage le veut dans le monde arabo-musulman.