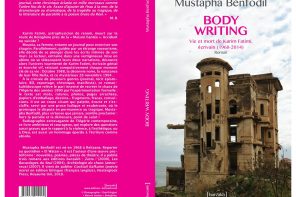Karim Moussaoui, cinéaste algérien, signe son premier long métrage En Attendant les hirondelles, sorti dans les salles françaises le mois dernier. Célébré comme une renaissance du cinéma algérien, quel nouveau regard cet opus, qui est une coproduction algérienne, française et allemande, nous offre-t-il sur l’Algérie ?
Les hirondelles de Karim Moussaoui volent bas sous un ciel algérien, froid et chargé.
Le film se déploie en trois tableaux distincts, un triptyque qui questionne la société algérienne, aujourd’hui. Nous suivons trois personnages qui se croisent tout en suivant des destins parallèles. L’objectif passe d’homme en homme, de voiture en voiture, au fil de la route. Les routes algériennes cabossées, bouchonnées deviennent ici des passeuses, des médiatrices entre plusieurs morceaux de vie. On traverse des paysages semi-urbains, aux murs parfois inhabités, des fantômes de construction en cours et les lampadaires croisés de loin en loin semblent autant d’yeux glauques. Des déviations, des chemins cahoteux, on s’immobilise. On n’avance pas cependant ; on circule ; on revient au départ.

Mais quel départ ? Jusqu’où remonter ?
Chacun des tableaux est une manifestation du passé dans le présent, et comme une impossibilité d’aller vers l’avant. D’abord, on rencontre un promoteur immobilier pris entre son ex-femme intellectuelle arabophone, froide et sévère, -une montagne-, et sa nouvelle femme complètement francophone, sans aucun accent sinon celui de la légèreté. Représentent-elles chacune une facette de l’Algérie ? Une arabisante, ancrée dans la ville, l’autre francophone qui regarde vers l’ailleurs ? Comment ne pas entendre les discordances, les accents faux d’une langue empruntée dans ces premières scènes ? L’homme, lui, lâche devant le danger, incapable d’aider son propre fils, n’est rien d’autre qu’un quinquagénaire sirotant ses remords au fond d’un verre d’alcool – est-il le symbole d’une génération qui végète ? Stylistiquement, ce premier volet nous offre des plans de la route, de nuit, vibrants, un enchevêtrement de lignes, de droites et de courbes de lumières et d’ombres – le paysage urbain en est aliéné. Quelles langues, quelles routes, tout autant étranges et cahoteuses choisir alors ?
Puis, apparait cette jeune fille, farouche pour commencer, qu’on suit à travers le regard de son ancien amour, cette jeune fille qui va aller se marier parce qu’il faut se marier. Ironie du sort, c’est celui qu’elle aime encore qui l’emmène rejoindre son futur mari. Elle est prise entre un besoin de liberté et les interdictions patriarcales. Toutes les frustrations de ces deux jeunes, leurs impossibles amours, sont tissées entre les parenthèses étouffantes d’un voyage en voiture, un convoi où la marchandise est une femme, et où le silence est inhumain ; des parenthèses entre lesquelles les seules respirations possibles se font au rythme de la danse chaloupée qu’offre la fille dévoilée au garçon qui l’aime encore, presqu’aussi envoutante que Hafisa Hersi dirigée par A. Kechiche, sur les notes inattendues de Rania Raï, autre résurgence du passé, dans un hôtel perdu entre des paysages rocailleux.

Enfin, la dernière histoire rappelle la guerre civile à l’écran, celle qui a saigné l’Algérie dans les années 90, dont on ne parle que pour dire qu’on n’en sait rien en somme. Une femme vient demander réparation à un médecin, elle lui demande de reconnaître son enfant, né d’un viol auquel il a assisté -témoin mutique, ce médecin n’était rien d’autre qu’une victime lui aussi de la guerre. A travers cette femme, c’est toute l’Algérie qui demande réparation, qui cherche un responsable. Les victimes se trouvent doublement, triplement condamnées quand les coupables ne sont jamais nommés. Et son enfant, celui qui ne s’exprime que des par des cris, est-il une volonté de faire résonner l’indicible ? Mais cette femme n’a pas réussi à me convaincre, le projet était-il trop ambitieux ? – ce dernier tableau, qui semble moins abouti, offre tout de même une scène saisissante : nous voyons cet homme comme pris de vertiges durant la cérémonie de son mariage, durant laquelle le contraste entre l’euphorie de la danse de groupe et son sentiment de solitude crée un malaise palpable.
Une Algérie vue par un Algérien, dénuée de tout folklorisme.
L’Algérie portée à l’écran est spectaculaire, froide et au rythme de l’adagio, elle est d’abord lenteur. Karim Moussaoui en défigure les images d’Epinal, il en affadie les couleurs et de fait en accentue les lignes de force. Les violences vues, décrites ou à peine mentionnées semblent elles-mêmes anesthésiées, ralenties ; elles en deviennent plus crues. Pas d’effervescence, pas de nervosité, tout s’écoule froidement. Et, de loin en loin, la danse l’emporte, le corps qui occupe l’espace, qui se réapproprie le présent, généreusement, sans gêne. Attendre les hirondelles, en Algérie, n’est-ce pas aussi absurde que d’attendre Godot ?
Alors, on peut se demander ce que seraient ces hirondelles qu’on attend absurdement, haletant presque sur le chemin ? On attend peut-être de sortir de ces visions des femmes que le réalisateur met en scène -Lila- Rasha- Aïcha, elles ne sont que des avatars de la condition des femmes, non pas seulement en Algérie, mais partout où les hommes dictent le regard. On attend probablement qu’on nomme les responsables. On attend assurément que s’élèvent d’autres voix encore, d’autres artistes algériens filmant, écrivant, croquant leurs villes, leurs territoires, et qu’ils disent, dans leurs langages, qu’ils montrent ce qu’on n’a pas pu, ce qu’on a pas su voir.