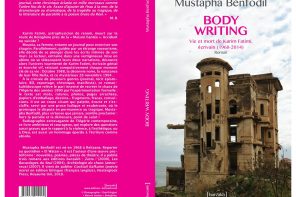Dans ma tête un rond-point (Fi rassi rond-point) est le premier long-métrage documentaire de Hassen Ferhani.
Sorti en salles le 24 février 2016, il a récolté de nombreuses distinctions dont le Grand Prix du Festival International du cinéma d’Alger, le Tanit d’or aux 26èmes JCC de Carthage, ou encore le Prix du meilleur documentaire international au Festival du Film de Turin.
Une caméra-témoin se pose discrètement dans le plus grand abattoir d’Afrique, quartier du Ruisseau – ex rue des Fusillés, à la périphérie algéroise. Dans ce harem masculin, des hommes donnent la mort pour gagner leur vie. Pourtant, les bêtes ne sont qu’un prétexte pour libérer la parole. Le sang ne suggère pas l’ensauvagement et le spectacle de la viande est volontairement occulté.
Dépouillé de ses lieux communs, l’espace devient un incubateur de consciences politiques. Un jeune homme d’une vingtaine d’années et son camarade surnommé « le kabyle » refont le monde quand d’autres racontent l’âpreté de leur quotidien. L’armée, la France, Zidane, les prophètes, tout y passe. Ils ne sont pas acteurs, parlent à cœur ouvert, étalent leurs psychologies comme dans une télé-réalité de prolos qui ne dit pas son nom. Ces frères de condition se confient l’intimité de leurs rêves, avec pour seul contact avec l’extérieur des coups de téléphones, souvent des voix de femmes, et des écrans qui alternent films américains et matchs de foot.
L’abattoir devient un théâtre de proximité, une intrusion chez une jeunesse aux prises avec une broyeuse d’espoirs. Otages de ce huis clos en apesanteur, les bruits et les odeurs accompagnent les journées pénibles comme une mort lente. La lenteur des séquences, c’est celle de l’Algérie d’en bas, une lenteur écœurante et résignée. Ces travailleurs qu’on ne veut pas voir sont pour bon nombre d’entre eux venus de l’intérieur du pays, avec leurs codes et leurs accents, troubler l’image mi-bourgeoise, mi-citadine de la capitale.

Malgré quelques flottements et des plans fixes à répétition, le film ne tombe ni dans l’hygiénisme esthétique, ni dans le documentaire animalier. Les couleurs saturées des néons côtoient un univers sonore ponctué de morceaux de raï ou de chaabi, l’un des ouvriers s’improvisant même troubadour dans cette absurde triperie. Cependant, le rythme sourd des gestes et des machines révèle l’abrutissement des corps et des esprits. Sous leurs maillots de sport contrefaits et maculés de sang, ils sont soumis au travail industriel. Au milieu des cadavres et des ossements, eux aussi sont encerclés.
Dans ma tête un rond-point dépeint surtout les contradictions d’un pays entre l’opulence presque obscène des kilos de viande face aux mâchoires édentées des comparses, fable moderne du cordonnier mal chaussé dans un pays à deux vitesses, et dans ce quartier en pleine mutation où l’abattoir côtoie la Banque d’Algérie et des sièges d’entreprise. Le film est un miroir qui ne se veut ni grossissant, ni euphémisant, reflète un pan de la société sans prétention mais boursouflé de poésie. C’est une invitation pour nous défaire de nos faux semblants et épouser un autre regard, plus familier, plus sincère. Sans être ouvertement engagé, le film raconte un Alger paupérisé, de ceux qui subissent la gentrification et le déclassement.
A couteaux tirés sur des dominants réels ou fictifs, les personnages évoquent des système d’oppression qui abiment leurs parcours de vies, la volonté du régime d’acheter la paix sociale et leur refus d’un scénario « Printemps arabe » pour le pays. Dans ma tête un rond-point, c’est aussi un aperçu de ce que peut être la mondialisation malheureuse, celle qui génère la misère sociale et qui pousse à l’exil.
Cruel, il ne tombe pourtant pas dans le misérabilisme. A un moment, l’un des ouvriers parle presque amoureusement à son oiseau qui aurait migré d’Angleterre en bateau et troqué ses papiers britanniques contre un passeport algérien. Cette scène condense toute la beauté de la démarche cinématographique. La puissance des portraits et la voix-off aidant, nous sommes même saisis par des moments de grâce, une tournure de phrase, un sourire en coin. Au cours de cette intrusion dans la routine des précaires, l’amertume des protagonistes côtoie le panache de leur humour. Entre l’angoisse nocturne de l’agent de sécurité et la folie douce du vieillard qui s’endort avec son chat à même le sol, la caméra redonne toute son humanité à cette communauté du sort.
Dans ce tableau d’une heure quarante, Ferhani réussit le pari de nous faire apprécier des fragments de vie magnifiés par une photographie naturaliste sans sacrifier la réalité crue.
Un film qui parle aux entrailles.