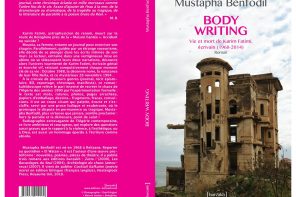Dans Razzia, le réalisateur marocain Nabil Ayouch fait bien malgré lui la démonstration des écueils du cinéma marocain dit d’auteur.
Nous rencontrons Salima, Hakim, Joe, Yto, Ines, et Abdallah, 5 personnages qui traînent leur mal-être à Casablanca. Leurs solitudes se mêleront d’une manière ou d’une autre dans cette ville où viennent s’échouer les chagrins, tandis que le spectateur s’endort devant 2 interminables heures d’atermoiements.
 Le choeur de l’ennui
Le choeur de l’ennui
Avec ce film, Ayouch fait montre d’une ambition qui se transpose dans la forme chorale du film, particulièrement complexe à mettre en œuvre avec succès. Par un kaléidoscope d’intériorités, Ayouch prétend faire le diagnostic des faux-semblants d’une société marocaine au bord de la crise de nerfs collective.
Si la prise de risque est louable, l’exécution est médiocre. Un tel parti pris est impitoyable, car en multipliant les personnages principaux et leurs trajectoires individuelles, on multiplie également les occasions de se louper en se vautrant dans des impasses, des facilités, des redondances ou des insuffisances. Or, bingo, Razzia en est un cas d’école tant la structure du film met en exergue tous les défauts d’un scénario indigent qui décline à foison les mêmes tics d’écriture pour présenter la subjectivité de ses personnages. Et ce, pour notre plus grand déplaisir.
Le film nous présente donc ses 5 personnages à l’intérêt, et au jeu d’acteur variables. Ce sont des êtres esseulés qui portent chacun un fardeau intime et social. Ils peuplent des strates sociales qui rendent compte d’une société fragmentée. Seul le préquel se déroule dans un espace distinct, du fond des montagnes du Moyen-Atlas, dans les années 80.

Amine Ennaji dans Razzia – © Unité de Production – Les Films du Nouveau Monde – Artemis Productions – Ali n’ Productions – France 3 Cinéma
Abdallah, un instituteur dévoué, joué par l’excellent Amine Ennaji, officie dans un village reculé. Il y est adoré des enfants, et d’Yto, jeune veuve à la volonté de fer. Bientôt, il se trouve confronté aux absurdités nationales. Les réformes de l’enseignement ont tranché, il faut désormais enseigner en arabe, une langue tout à fait étrangère à ces enfants exclusivement amazighophones. Les idéaux d’Abdallah sont pulvérisés face la déraison d’Etat, et il observe avec douleur ses élèves se débattre avec ces sons qui ne leur disent rien, dépossédés de leur droit au savoir. Ecrasé, Abdallah capitule et disparaît dans la nature, abandonnant son amour pour Yto. Cet épisode, pourtant prometteur, sera le seul moment de grâce du film. Il est à la fois irradié par la lumière de l’Atlas et l’épure du jeu d’acteur et de la nature environnante.
Nous retrouvons ensuite Yto dans le Casablanca contemporain, désormais théâtre de l’action. C’est une vieille femme taciturne qui est devenue figure d’autorité dans la vieille ville. Salima (Maryam Touzani), jeune femme aux atours modernes lui rend visite comme à un sage. Derrière les apparences de la modernité, elle vit en fait dans un ménage malheureux, aux prises avec un tyran domestique. Ce trio forme un ensemble cohérent et charismatique autour duquel sont pourtant greffés des personnages dispensables qui siphonnent le film, et qui ne se justifient que par leur incarnation d’une certaine catégorie ou minorité sociale. La disparition d’Abdallah est vite éclipsée par les lourdeurs scénaristiques, et son absence est rappelée au spectateur par une pirouette ; le recours à la voix off de l’acteur.
En choisissant d’étayer son propos par la palette des personnages plutôt que par le récit, Ayouch déraille totalement le rythme de son film. Il transpose en fait le même traitement à chacun de ses personnages, pour servir le même constat ; celui d’une société asphyxiante, d’une anomie sociale désespérante. Mêmes bavardages qui pallient à la platitude de la mise en scène, mêmes genre de mises en situation pour illustrer les masques sociaux portés face à l’adversité de la société, même absence d’enjeu fort qui nous laisse dériver au fil des petites misères quotidiennes de chacun, donc, même ennui. De plus, le fil conducteur est quasi-inexistant au vu d’une construction brouillonne qui alterne entre les personnages de manière souvent aléatoire, alors même que leurs liens les uns avec les autres sont parfois peu convaincants, et qu’ils s’entrecroisent finalement avec force de raccourcis bancales.
Razzia est tout à la fois décousu et systématique, en somme, c’est un film amorphe.
La pédagogie au cinéma ou téléfilm social
Si l’écriture est dispersée, l’intention du réalisateur, elle, est martelée à chaque plan. D’abord, la matière même du film est un catalogue de personnages idéaltypiques. Il y a le jeune artiste homosexuel, la femme en quête d’émancipation, le juif, ou encore l’adolescente bourgeoise. S’ils représentent chacun une classe sociale différente, tous subissent leur aliénation à la marge. Un véritable échantillon statistique pour servir le discours qui dépeint une société hypocrite où un modernisme de façade écrase l’individu et vernit les inégalités.
Or, certains personnages n’existent que par leurs particularismes de sujets sociaux. Leur caractérisation grossière et utilitariste est d’ailleurs l’un des écueils les plus communs d’un cinéma social qui forme la majorité de la production marocaine dite d’auteur. Cette galerie sert à la dénonciation dans une vocation pédagogique. L’histoire, le souffle, la poésie, l’image – l’art en somme – sont étouffés sous une déferlante de bons sentiments.
Ces personnages creux agissent dans des situations tout aussi creuses. Parce qu’ils n’ont pas de vie propre, chaque séquence est moulée pour et par le discours social de l’auteur. En résulte un empilement de clichés, ou même d’invraisemblances, dont un exemple cocasse est notre rencontre avec la prostituée des rues à la fois curieusement francophone et antisémite. Quand elles ne sont pas en toc, les scènes retranscrivent les contradictions que Ayouch entend révéler dans un premier degré confondant. Une séquence particulièrement étrange met en scène Inès toute à sa prière, tandis que sur le même plan, l’écran de son ordinateur fait défiler les images dénudées et les paroles criardes d’un clip. Bon sens d’écriture et subtilité du symbole qui n’a pas manqué de faire rire la salle de cinéma entière, à Casablanca. Seules les séquences de Salima, et notamment les scènes dansées, portent en elles une certaine énergie vitale. Peut-être parce que Maryam Touzani est à la fois actrice et coscénariste du film?
En somme, puisque tout est prétexte à servir une intention omniprésente, le film n’arrive jamais à saisir une vérité des personnages ou de l’époque, il ne produit qu’une sorte de caricature de société. Tout est canevas, et donc pose.
Cela est d’autant plus criant dans le final ubuesque qui tente l’électrochoc pour ranimer un film, – et un spectateur -, jusque là ronronnant(s). Dans une interprétation encore une fois très littérale de la lutte des classes, Ayouch conclut par la confrontation sanglante entre une bourgeoisie détestable, et un peuple furieux. Tout au long du film en effet, une grogne sourde se fait plus en plus violente dans les rues. Cette rage collective explose enfin jusqu’aux sanctuaires des riches. Il semble que la colère propre à chacun de nos protagonistes prend corps dans cette foule en furie tandis qu’ils la traversent en observateurs silencieux. Seulement voilà, la tension est immédiatement desservie par un portrait véritablement cartoonesque d’une jeunesse dorée marocaine, tellement infecte qu’elle en devient comique. Un vrai sketch qui réduit immédiatement toute la portée des images. Cette binarité désolante découlant encore une fois de la petite dialectique qui sous-tend tout le film.
Pour conclure, Razzia est un film étonnamment poussif. L’intention pédagogique et sociale de Nabil Ayouch le plombe tout à fait puisque le regard porté sur la société est lui-même, – quelle ironie ! -, monolithique, totalement engoncé dans ses propres schémas de pensée préétablis. D’autant plus que la structure chorale du scénario réduit le film à une succession de scènes anecdotiques.
Les succès précédents de l’auteur, que ce soit Ali Zaoua, Les Chevaux de Dieu, ou Zine li fik (Much Loved), partaient d’abord de la maîtrise documentaire d’un terreau social bien défini, d’un microcosme (les enfants des rues, le bidonville de Sidi Moumen, le milieu de la prostitution marrakchie) qui permettait de laisser s’épanouir des personnages intéressants aux trajectoires fortes. En voulant radiographier la société marocaine dans son ensemble, Nabil Ayouch a produit un film fade qui tombe dans tous les écueils du cinéma social édifiant dont le public marocain est familier. En somme, le film est bien plus symptomatique des rengaines d’un certain cinéma marocain, que de la société qu’il dépeint.