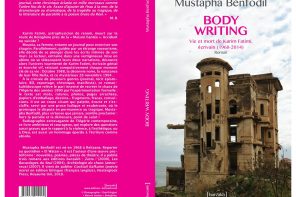Albert Dichy est directeur littéraire à l’IMEC (Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine). Spécialiste de Jean Genet, il a rassemblé les archives d’écrivains majeurs du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord : Kateb Yacine, Georges Schéhadé, Adonis, Andrée Chedid, Tahar Ben Jelloun, Abdellatif Laâbi ou encore Vénus Khoury-Ghata.
Quel chemin vous a mené vers la littérature ?
Je suis né à Beyrouth, dans une famille de la communauté juive. Mon père venait d’Égypte, et ma mère était d’origine turque. La langue commune de mes parents était le français. J’ai fait le choix de travailler sur la littérature en langue française, tandis que mon frère a suivi une ligne arabophone. Ce choix littéraire français m’a reconduit, sans que je le prévoie ou sans que je le devine, vers la relation entre l’Orient et l’Occident.
De quand date votre rencontre avec Jean Genet ?
J’ai rencontré Jean Genet pour la première fois à Beyrouth au début des années 1970, lors d’une réunion politique pour la cause palestinienne. Je connaissais à peine le nom de Genet. J’ai tout de suite été frappé par une chose : il n’avait rien de l’écrivain célèbre en terre étrangère. Genet n’était pas en voyage, il était dans un territoire sur lequel il ne régnait pas. Il était dans l’espace de l’autre, avec la conscience d’être accueilli.
Lorsque j’ai commencé à étudier son oeuvre, trois ans plus tard, il n’avait encore publié aucun de ses textes sur l’Orient. Pourtant, c’est Genet qui m’a fait revenir en Orient. J’avais quitté le Liban au moment de l’éclatement de la guerre civile. Je pensais rester quelques mois à Paris. Être juif est devenu une question dangereuse au Liban, surtout à partir de 1984. Je suis retourné au Liban pour la première fois, après 17 année d’absence, pour tourner un documentaire sur Jean Genet.
Nos trajectoires se sont croisées. Au moment où je quittais le Liban pour aller en France, Genet quittait la France pour le Proche-Orient. Et ce croisement m’a fait revenir.
Jean Genet découvre l’Afrique du Nord et le Proche-Orient lorsqu’il s’engage dans la légion étrangère à 18 ans. Il ne cessera de regarder l’autre rive de la Méditerranée. Comment lisez-vous ce rapport à l’Orient ?
Le rapport de Jean Genet à l’Orient est très ancien. À 14 ans, il s’évade d’un centre d’apprentissage. Le directeur écrit que Genet disait vouloir travailler « dans les cinémas en Égypte et en Amérique ». Or, aux extrêmes de sa vie, Genet soutiendra deux mouvements politiques : la cause palestinienne et les Black Panthers aux États-Unis.
Je pense que lorsque Genet s’engage dans les troupes du Levant, en 1925, il porte encore en lui cette image qui vient de l’enfance. Il débarque d’abord à Beyrouth, puis à Damas. Il tombe immédiatement amoureux du monde arabe. Il sortait de la colonie pénitentiaire et pour la première fois il rencontrait des gens qui n’avaient pas un rapport rude avec lui. Le lien politique et amoureux naît à cette époque, et il s’origine dans des images.
Tout le périple politique de Jean Genet est déterminé par un imaginaire. Il est lié au désir de partir. Genet est à la fois l’homme du plus petit lieu, la cellule, et du grand espace.
Quelle est la trajectoire politique de Jean Genet ?
Genet appuie des mouvements qui entrent dans l’illégalité. Il s’intéresse au sort de ceux qui souffrent et se révoltent, ceux qui se dressent dans une lutte désespérée. Il faut qu’il y ait une oppression, une révolte, et d’une certaine façon un désespoir. Il faut que la lutte soit libre de toute réalisation possible. Il s’intéresse au « moment de l’éclatement hors de la honte », comme il l’écrit dans Quatre heures à Chatila. C’est un moment de renversement, lorsque les Palestiniens, auparavant désignés comme « réfugiés », deviennent des fedayin (combattants).
Quelque chose de l’écriture de Genet est aussi touché par son rapport avec l’Orient. Il lit beaucoup, des poètes arabes et soufis. Son écriture se délie.
Est-ce un effet de son séjour au Proche-Orient, ou une forme de sagesse – même si ce mot s’applique peu à Jean Genet ? Son écriture se simplifie, s’apaise, peut-être parce que pour la première fois, il dit qu’il se sent chez lui dans les camps palestiniens.
Une autre figure a compté pour vous, celle du poète libanais Georges Schéhadé, que vous avez très bien connu.
Georges Schéhadé a vécu au Liban presque toute sa vie. Il n’est venu en France que dans les dernières années, dans une situation d’exil. Le Liban n’est jamais nommé dans son œuvre. On pourrait presque penser qu’il y a un effacement de la question de l’Orient, si elle ne revenait pas dans l’écriture même, ce qui l’imprègne, ce qu’elle évoque, ses images. Elle est intrinsèquement mêlée à l’écriture. Il disait que l’écrivain ouvre une fenêtre, non sur un pays réel, mais sur un pays intérieur et imaginaire où l’œuvre puise ses sources. Lorsqu’on lui reprochait de ne pas écrire sur le Liban, il répondait : « Le Liban est dans mon oeuvre comme un secret ». Un secret, c’est ce qui sécrète, ce qui n’est pas fixable ni saisissable.
Dans les poèmes de Georges Schéhadé, le Liban est présent comme une musique, ou un parfum.
Les archives de l’Afrique, des Caraïbes et du Proche-Orient à l’IMEC sont marquées par la lutte contre le colonialisme. On y trouve la revue Présence Africaine, les écrits d’Ahmadou Kourouma et de Frantz Fanon. Le plus grand écrivain algérien y trouve sa place, Kateb Yacine.
L’œuvre de Kateb Yacine s’identifie au geste-même de l’indépendance de l’Algérie. Nedjma est une figure de femme et incarne toute l’Algérie. Kateb Yacine lutte pour l’indépendance en langue française. Il parle l’arabe mais ne l’écrit pas. Il se saisit de la langue française pour combattre la colonisation. Il considérait la langue française comme un « butin de guerre » et disait « J’écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français ». Dans une seconde partie de son œuvre, il souhaite créer un théâtre populaire en langue arabe dialectale. Ici, les archives sont passionnantes. Les manuscrits des dernières pièces de Kateb Yacine sont des cahiers où il écrit l’arabe dialectal avec l’alphabet latin. La traduction en berbère apparaît à côté.
Trois langues se croisent dans la même page. La circulation entre l’arabe, le français et le berbère est telle qu’on ne sait plus quelle est la langue originale de ces pièces de Kateb Yacine.
Kateb Yacine nous montre la richesse des relations entre les langues et la littérature. Que pensez-vous de l’appellation « littérature francophone » ?
Le terme de francophonie cache ce qui est en jeu dans les œuvres francophones. Andrée Chedid est perçue comme un écrivain complètement francophone, alors que le premier livre qu’elle publie est en anglais. Edward Said nous invite à penser ces croisements linguistiques. Après avoir écrit L’Orientalisme, il est revenu sur certaines propositions grâce à la notion d’hybridité, qui joue sur l’idée de frontière.

Andrée Chedid, Face aux violettes. Tapuscrit avec corrections de l’auteur. Fonds Andrée Chedid / IMEC
Comment s’est constitué le fonds d’Afrique du Nord et du Proche-Orient à l’IMEC ? Quelle est son histoire ?
Le fonds s’est beaucoup constitué par le hasard des rencontres, à travers des relations humaines avec les auteurs. J’étais libanais, et j’avais un lien fort avec toute la littérature méditerranéenne. Je connaissais Georges Schéhadé, Andrée Chédid, Adonis, avant qu’ils ne décident d’entreposer leurs archives à l’IMEC.
L’idée de travailler avec des auteurs contemporains est au cœur de notre projet. Nous souhaitons rapprocher la création et l’archive. Nous avons aussi le désir de travailler sur la convergence ou la continuité des auteurs. Les auteurs ont envie de se retrouver ensemble, dans des espaces communs. L’espace Proche-Orient s’est constitué sur ce modèle : Adonis a eu envie de déposer ses archives près de celles de Georges Schéhadé.
Que nous racontent les archives d’un écrivain ? Dessinent-elles un portrait de papier, inévitablement fragmentaire ?
Un ensemble d’archive dessine un portrait ne serait-ce que par un rapport des auteurs avec leurs documents, à chaque fois différent. La maison d’un écrivain conserve parfois plus qu’il ne le pense lui-même. Certains auteurs ont un rapport délibérément destructeur à leurs archives.
Jean Genet et Kateb Yacine sont des auteurs qui ont dispersé avec soin leurs archives. Tous deux étaient des écrivains nomades.
Chaque auteur imprime une marque singulière. Pour Adonis, la presse joue un très grand rôle : les polémiques, les litiges, les affrontements, comptent beaucoup. C’est une presse internationale, souvent en langue arabe, provenant de pays où le souci de conservation fait parfois défaut. C’est pourquoi il découpe les articles et les conserve précieusement.
L’archive offre aussi sa propre esthétique. En Occident un manuscrit très bien écrit n’a pas plus de valeur qu’un manuscrit griffonné. Nous avons même une sensibilité aux biffures, aux corrections, aux mouvements du texte. Adonis, en revanche, porte un intérêt esthétique à ses manuscrits. Il y a là un héritage de la tradition calligraphique arabe : un texte très bien écrit est un art. Ce serait peut-être un trait de l’orient, que l’on retrouve dans la graphie très élégante de Georges Schéhadé.
Quelle est la pertinence de l’IMEC comme lieu de préservation des archives d’écrivains orientaux ?
Les archives n’ont pas de lieu approprié. Elles ont un caractère hybride et cosmopolite, sans détermination sociale, régionale ou nationale. Leur localisation ne les transforme pas et n’ajoute pas de valeur particulière.
Les œuvres ont toujours énormément voyagé. Plutôt que d’exiger à tout prix la restitution des archives, je pense qu’il est plus intéressant de créer des centres culturels autour d’une œuvre dans leur pays d’origine. Mais il faut être attentif à la question patrimoniale quand elle touche des pays moins riches, moins puissants. Il y a dans la francophonie un risque de reconstituer la nostalgie d’un ancien empire.
Le désir de possession des archives est devenu un enjeu diplomatique et les manuscrits sont considérés comme des objets de grande valeur.
L’enjeu des manuscrits est souvent imaginaire ou mythologique, il joue sur des rapports de puissance.
On possède les archives comme si on détenait un trésor. Le pire concept qui a été pensé pour les archives, c’est celui de trésor national. Les archives sont des objets d’étude. Ce qui est un trésor national, ce sont les œuvres, et ce sont elles qui doivent circuler.
Quel tableau dressez-vous de la protection du patrimoine littéraire dans les pays de culture arabe ?
L’Afrique a une pratique marginale de la conservation, même si des manuscrits très précieux ont été conservés, en particulier à Tombouctou. Le monde arabe est le berceau de l’écriture, mais il y a peu de lieux d’archive. Au Liban, en Irak, et en Égypte, ce sont des lieux hérités des espaces religieux anciens, tenus par les Chrétiens d’Orient et les Musulmans. Ils sont parfois passés dans le domaine public, comme la bibliothèque nationale du Caire. Un équipement très important est nécessaire afin de lutter contre les effets de la chaleur et de l’humidité. La bibliothèque royale du Maroc est une exception. Son directeur l’a dotée de moyens de conservation importants. Le Proche-Orient et l’Afrique sont aussi des territoires politiquement instables.Prenons les archives d’Adonis, qui est un auteur de premier plan dans l’espace arabe, un des acteurs majeurs du renouvellement de la poésie contemporaine par ses recueils et ses revues.
Adonis a lui-même rapportées ses archives dans des valises de Syrie, à chacun de ses voyages. Où les déposer, aujourd’hui ?
Beaucoup d’archives du Proche-Orient ou d’Afrique sont conservées à l’IMEC au titre de dépôt à long terme. Un jour, peut-être, si le pays d’origine se dote d’instruments capables d’accueillir ces archives, les manuscrits pourront leur être donnés.
L’IMEC avait parrainé le Centre du patrimoine musical libanais. Quelles initiatives menez-vous envers les pays du monde arabe ?
Nous menons aussi des actions de formation et de logistique, mais il faut qu’un désir soit exprimé. On peut aussi restituer des manuscrits à leurs pays d’origine, sans que cette restitution soit toujours matérielle. La numérisation transforme la question de la possession d’archives de façon radicale. L’archive tire sa force de l’unicité, alors que le numérique tire sa force de la pluralité. De nouveaux modes de partage peuvent se dessiner, que l’on ne connaît pas encore.
La plupart des auteurs travaillent sur ordinateur. Pour le moment l’ordinateur a augmenté la masse des manuscrits parce que les écrivains impriment et corrigent sur le papier. Mais un jour, on ne passera plus par la médiation du papier. La qualité de la reproduction numérique sera telle qu’elle sera l’égale du papier. À ce moment-là, l’archive deviendra elle-même immatérielle.
La notion d’original va disparaître, et avec elle, on perdra sûrement un des charmes de l’archive, qui est d’être fragile. Une œuvre immense commence par des bouts de ratures sur du papier. Les choses les plus belles, les plus importantes, les plus puissantes, reposent sur la pratique la plus éphémère : l’écriture à la main. C’est ce qui m’émeut le plus.