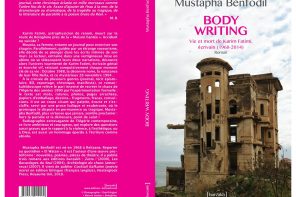Née à Bagdad, Alia Mamdouh vit actuellement à Paris. Elle est l’auteure de recueils de nouvelles, d’une chronique de la vie littéraire arabe et de plusieurs romans. La romancière désosse la conscience de l’Homme contemporain.
Il arrive que la rencontre avec une écrivaine se fasse sur le seuil des choses ordinaires, voire extrêmement banales. C’est un temps qui s’adresse à un autre, une génération qui succède à une autre. L’être témoigne pour l’autre en léguant ses espérances et ses échecs.
Rédactrice en chef du magazine irakien Al-Râsid, puis journaliste à Beyrouth et à Rabat, Alia Mamdouh est lauréate du Prix Naguib Mahfouz du meilleur roman arabe en 2004 pour Al-Mahmboubate (Les biens-aimées). Torturés par leurs passions et leurs aspirations, écrasé par le poids de la guerre et des restrictions, ses héros traversent les malheurs de notre époque à la recherche de la liberté.
Bagdad, Beyrouth, Rabat, Cardiff: vous avez vécu et écrit dans plusieurs villes. Des villes pour lesquelles vous rappelez votre rattachement. Pourtant, vous n’acceptez pas le concept d’intégration. Quelle en est la raison ?
Alia Mamdouh : A Paris, bien que je ne maîtrise pas parfaitement la langue, je reste impliquée dans la vie culturelle. Toutefois, vis-à-vis de la société, je reste en marge mais cela ne veut pas dire que je suis marginalisée. Ce que j’aime dans mon errance parisienne est que j’ai un espace de liberté qui me laisse le choix de la non-intégration.
C’est un thème qui est au centre des débats actuellement… Comment le percevez-vous ?
A.M : Aujourd’hui, les hommes et femmes politiques ont une obsession vis-à-vis de cette question de l’intégration. Or, je considère qu’il doit toujours y avoir une distance entre nous et le pays qui nous accueille. Certaines personnes acceptent les cultures étrangères tandis que d’autres exigent une assimilation. Autrement dit, il n’y a pas de place pour la culture de l’Autre, la culture du pays d’accueil doit s’y substituer. Or, ceci n’est pas acceptable!
C’est un mal éternel : les êtres humains ont cette fâcheuse tendance à rejeter leurs problèmes sur les autres. Mais, en réalité, l’être humain n’a qu’un unique problème : c’est avec soi ! Si je ne fais pas face à ma propre personne, je ne pourrais jamais faire face à l’Autre et plus tard envisager de cohabiter avec lui.
Il est toutefois vrai que cette entreprise n’est pas facile. Faire face à soi implique de se confronter à ses errements et ses défauts, ce qui est difficile à assumer. C’est ici qu’intervient le travail de l’écrivain : il est sans cesse dans cette recherche de la confrontation avec soi-même.
Est-ce dire pour autant que l’écriture est salvatrice ?
A.M : Il arrive parfois que l’écriture soit incapable de vous sauver. L’écriture est un bonheur mais il se peut parfois qu’elle vous torture. L’écriture relève tout ce qui est bon, mauvais, ironique et indécent chez nous. Elle fait parfois ressortir ces choses honteuses qui sont en nous et que nous nous obstinons à renier. En somme, elle nous pousse à les découvrir.
Mais est-ce que l’écrivaine est obligée de livrer au public ce qu’elle a de bas ? N’est-elle pas en train de s’affaiblir devant les autres ?
A.M : Si elle souhaite écrire avec force et de manière authentique, alors c’est un passage obligé ! Et puis, cela ne correspond pas forcément à une bassesse. Ce dont il est question, c’est d’un acte tout à fait humain. Je suis une partie intégrante de l’humanité : mes défauts sont les tiens. L’écriture me permet alors de sonder mon moi, de l’appréhender et le connaître. C’est également une manière de connaître l’Autre.
Ma représentation de la réalité sous-entend déjà un certain décalage avec le réel. Il n’est plus question de la réalité ou disons plutôt que le degré de réalité évolue. Kafka dans la Métamorphose se représente en insecte. Pourtant, ce n’est pas de l’animal dont il est question mais de ce sentiment d’humiliation que Kafka se représente.
Dans votre roman La Passion, nous retrouvons Mus’ab, cet homme irakien dominateur et Widad, une jeune femme soumise au diktat de son époux. Ne craignez-vous pas qu’à travers ces personnages, vous puissiez nourrir ou renforcer des stéréotypes orientalistes ?
A.M : Pour être honnête, je n’ai pas cette crainte et n’ai pas peur de l’accusation orientaliste. Cela s’explique par le simple fait que la femme souffre autant en Occident qu’en Orient. Il suffit de voir ce qui se dit ici sur l’inégalité salariale, la violence conjugale et l’harcèlement sexuel. Dit autrement, j’ai délaissé cette confrontation Orient-Occident, qui n’a ici aucun intérêt pour moi.
La Passion se construit autour des êtres blessés et torturés. Mes personnages renvoient davantage à des idées. Mu’sab est en réalité cet homme faible et misérable et c’est ce qui explique son autoritarisme. S’il crie sa virilité, c’est qu’il n’a pas confiance en lui-même.
La plupart de vos héroïnes sont des femmes. Pourtant, vous ne vous considérez pas féministe. Qu’est-ce qui vous éloigne du féminisme ?
A.M : Je refuse ce titre car je n’ai pas cette obsession qui se limite aux femmes. Ce n’est pas parce que je parle de la condition des femmes que je dois forcément être considérée comme une écrivaine féministe. Je ne suis pas contre le féminisme mais je ne me reconnais pas dans les théories européennes et américaines sur la libération de la femme. Elle s’égarent, souvent, me semble-t-il, dans des considérations extrémistes. Je refuse la guerre des sexes !
Ce qui m’intéresse concrètement, c’est la pauvreté, l’humiliation et l’oppression qui touchent autant les femmes que les hommes. Mon travail de romancière consiste alors à représenter l’impact du réel sur la vie des personnages, sur leurs comportements et leur intériorité. Que mon héros soit un homme ou une femme, cela n’a pas d’importance.
Loin de votre mère-patrie, vous refusez de vous considérer comme une exilée. Où en êtes-vous aujourd’hui ?
A.M : Très bonne question. Je suis toujours à la recherche… Je n’aime pas cette notion d’exil puisque je n’ai jamais été militante d’un courant politique quelconque, c’est pourquoi je préfère le mot voyage. L’exil est un cas historique et politique qui exige un héroïsme que je ne possède pas.