Il y a des êtres dont la douceur vous touche avant même qu’ils ne disent un mot. Abdellah Taïa est de ceux-là.
A 41 ans, le romancier et désormais réalisateur semble en avoir 30 tout au plus. Entre pudeur et timidité, l’enfant de hay Salam devenu parisien d’adoption poursuit son chemin et crie la souffrance avec les mots. La sienne d’abord et maintenant celle des autres. La violence, omniprésente dans son œuvre, tranche avec la silhouette fragile et délicate du romancier. Pourtant, Abdellah Taïa ne cesse de dénoncer l’injustice, avec colère.
Dans un style et un univers qui lui sont propres, empreints de sensibilité et de poésie, il donne la parole aux destins brisés, à ceux que la vie malmène mais qui continuent d’espérer. Chez Taïa, les personnages errent, défient les normes et les interdits malgré leur statut de parias sociaux. Le corps, lui, est un instrument de plaisir mais également de pouvoir, de lutte, de conquête. Au fil des pages les mots claquent et les individus se fracassent. Puis se relèvent, toujours et encore. Rien n’est laissé de côté : sexualité, patriarcat, radicalisme religieux, tourments identitaires…
Depuis ses débuts en littérature, le lauréat du prix de Flore en 2010 a évolué et ne se limite pas à sa condition d’écrivain arabe et homosexuel à laquelle certains voudraient le cantonner. Ses premiers romans, largement autobiographiques, exploraient la découverte de son homosexualité (Le rouge du tarbouche, Une mélancolie arabe) où son exil en Suisse puis en France (L’armée du salut). Taïa a vécu la révolution de l’affirmation de soi, celle d’un individu qui ose devenir libre et s’affirmer différent dans une société qui le rejette, sans pour autant renier d’où il vient. Et c’est en cela qu’il dérange le plus ses détracteurs. Écrivain, réalisateur, intellectuel et même danseur (en 2012 il avait formé un duo avec la chorégraphe Bouchra Ouizguen pour le spectacle Karantika), Abdellah Taïa ose, explore, réinvente et se livre à l’état brut.
Moi, je refuse cet idéal marocain stérile. Cette platitude. Il ne me convient pas. Je le dépasse. L’idéal marocain, moi, à mon petit niveau, je le réinvente. Je le remplis avec un nouveau contenu, avec du sens, du courage et du doute…
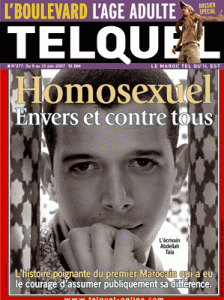 Dans la lettre adressée à sa famille publiée en 2009 dans TelQuel il indiquait refuser le modèle imposé, c’est à dire celui de la réussite matérielle au détriment de l’épanouissement personnel. Pour atteindre cet idéal il lui a fallu quitter son Maroc natal. Mais l’arrivée en France sera un choc car il faut apprendre à se détacher de « cette identité à laquelle les autres vous renvoient sans cesse, celle du maghrébin, de l’arabe, du musulman ». Cette identité construite qui vous assigne à résidence, niant votre singularité et vous condamne au silence, à l’invisibilité.
Dans la lettre adressée à sa famille publiée en 2009 dans TelQuel il indiquait refuser le modèle imposé, c’est à dire celui de la réussite matérielle au détriment de l’épanouissement personnel. Pour atteindre cet idéal il lui a fallu quitter son Maroc natal. Mais l’arrivée en France sera un choc car il faut apprendre à se détacher de « cette identité à laquelle les autres vous renvoient sans cesse, celle du maghrébin, de l’arabe, du musulman ». Cette identité construite qui vous assigne à résidence, niant votre singularité et vous condamne au silence, à l’invisibilité.
Un attachement identitaire à sa mère
Il aurait été alors facile de jouer la carte de la victime, mais Abdellah Taïa ne s’est pas libéré pour se voir enfermé dans le rôle de l’icône martyr. Renier le Maroc ? Au contraire. Dans la littérature de Taïa, le Maroc est la matrice. Le Maroc dans lequel il a grandi, entouré de djinns où le shour (sorcellerie) cohabite avec les sensuelles actrices égyptiennes des années 60. Le Maroc pauvre d’où il vient, celui de sa mère M’barka et de ses voisines de Salé dont il vole les vies pour en faire des fragments littéraires comme il aime à le dire. Quand Abdellah Taïa parle de M’barka, on pense à La civilisation ma mère. Dans ce sublime hommage autobiographique, désormais classique de la littéraire marocaine, Driss Chraïbi parlait de la « sensibilité du monde » et du « rythme fœtal » de sa mère. Taïa, lui, souligne la « façon poétique de voir le monde » de M’barka et sa vie rythmée par des rituels « beaux, étranges et envoûtants ». Ce n’est pas un hasard si les figures féminines du jeune romancier empruntent toutes quelque chose à M’barka, révoltées et courageuses.
« Ma mère, tu ne le sais sans doute pas, le désir de révolte, c’est toi qui me l’as donné. Chez nous, tu as toujours été le guide, la stratège, la révoltée. La réalisatrice. Ma mère, même analphabète, à toi toute seule, durant les 25 années que j’ai passées à côté de toi, tu étais une école de féminisme. Et quelle école ! Je t’admire. Je fais mieux que de t’aimer, je le répète : je t’admire ! Tu as imposé tes choix à mon père, à nous. Tu as réalisé ton œuvre : la maison de hay Salam. C’est toi qui économisais de l’argent, qui achetais du ciment, du sable, des briques, toi qui engageais les maçons et négociais avec le moqaddem. Tu as compris, tôt, que tu n’avais pas d’autres choix que celui d’être un homme à la place des hommes. Mieux et plus courageuse que tous les hommes qui nous entouraient. »
Défenseur des sans-voix
A l’instar de Chraïbi, Abdellah Taïa écrit en français. Paradoxe ? Oui et non. L’arabe est sa langue maternelle, mais fils de la schizophrénie identitaire marocaine, il a intériorisé très tôt qu’elle est « l’idiome du pauvre, de la stagnation, du non futur » face à un français symbolisant la langue des riches, du pouvoir et de l’ascension sociale. Alors le français il s’en sert pour parler de sa culture marocaine. Pour ce ould châab scolarisé à l’école publique, maîtriser la langue de la caste avec tant de maestria est le fruit d’un long travail auquel il s’est astreint à travers l’écriture d’un journal intime.
Abdellah Taïa se rappelle des livres que son père ramenait de la Bibliothèque générale de Rabat où il travaillait comme chaouch. C’est en réfléchissant sur lui-même qu’il en est venu peu à peu à l’écriture, qu’il s’est ouvert au monde. Pour lui la littérature appelle une vérité totale et nue. Une responsabilité vis-à-vis de soi et de la société d’où l’on vient. « Je suis dans le questionnement. Un livre, ça vient de soi, ça interpelle le monde, la société. » S’il a d’abord choisi les mots c’était pour dépasser la peur et la honte, pour s’assumer et donner une vision du monde. L’homosexualité a été le premier matériau pour ses romans mais désormais il défend les sans-voix, tous ceux qui subissent l’injustice.
Le jour du roi, un tournant dans sa carrière
A cet égard Le jour du roi a marqué un tournant. Ce roman parle du Maroc de Hassan II à travers l’amitié amoureuse d’Omar et Khalid, jeunes adolescents issus du même pays mais de deux mondes différents en proie à la lutte des classes. Sorti fin 2010, Le jour du roi aborde ouvertement l’abîme qui sépare les riches et les pauvres, comme si l’écrivain avait pressenti l’onde de choc du Printemps arabe. Abdellah Taïa a soutenu le mouvement du 20-Février dès le début, le qualifiant d’événement politique majeur de sa génération tout en déclarant son admiration pour ces jeunes révolutionnaires.
C’est à ces mêmes jeunes auxquels il s’adressait dans l’ouvrage collectif Lettres à un jeune marocain en 2009. Comme une main tendue vers la jeunesse marocaine abandonnée de tous, il exhortait ses concitoyens à se libérer du silence dans laquelle on les avait enfermés depuis leur naissance :
« Oui une lettre peut être le début, là, tout de suite, d’une révolte personnelle et collective. Une lettre pour exister. Faire exister les autres. Une lettre pour essayer de ne pas avoir peur. Ne plus de soumettre. Casser le paternalisme et le machisme. Parler et agir. (…) Des forces obscures nous emprisonnent, nous étouffent et empêchent qu’il y ait un jour une pensée vraie, grande, libre et politique qui touche et change tout le monde dans le pays. Il faut débloquer, décoincer le Marocain. L’aider à arrêter de tourner en rond. Lui donner à voir. A lire. »
Chez Taïa, les mots dénoncent les maux et la poésie devient une arme pour atteindre la liberté. Cette liberté voulue, assumée, même si elle s’accompagne d’un déchirement, d’une rupture. Même si elle signifie être seul contre tous. « D’abord, sois libre. Ensuite demande la liberté. » Abdellah Taïa incarne à merveille ces paroles de son poète fétiche, Fernando Pessoa.







