En réitérant l’expérience de 2014 au Beirut Exhibition Center, l’exposition Bridge to Palestine organisée par la Galerie Mark Hachem de Beyrouth, permet la réunion d’artistes qui ne peuvent se rencontrer d’ordinaire et met en lumière le dynamisme et le pluralisme de l’art contemporain de Palestine.
Désaxer le regard sur la Palestine
Pluralité dans les provenances géographiques, les milieux sociaux, l’appartenance générationnelle ou encore les pratiques plastiques. Tous nés entre 1937 et 1980, ils viennent de Gaza, de Cisjordanie, de Jérusalem ou de la diaspora, des camps de réfugiés ou de la bourgeoisie palestinienne. Ces seize artistes aux horizons multiples nous immergent au cœur de l’art contemporain palestinien et créent ensemble, un pont symbolique vers leur pays d’origine, la Palestine. L’exposition permet de percevoir comment des artistes investissent autrement la « question de Palestine » et permettent de dessiller le regard sur elle. A travers des créations éclectiques, contemporaines et expérimentales, c’est une approche inédite du conflit qui nous est offerte.
Ils viennent de Gaza, de Cisjordanie, de Jérusalem ou de la diaspora, des camps de réfugiés ou de la bourgeoisie palestinienne.
Loin des images sanglantes de guerres, cette exposition bat en brèche les clichés sur la Palestine. Nombre de ces artistes expriment la manière dont l’occupation influence et façonne le quotidien des Palestiniens. D’autres dessinent une cartographie alternative du pays. Ce sont des visions personnelles, parfois nostalgiques, souvent humoristiques, qui émanent de chacune de ces œuvres, forgeant un contre-récit, plus réaliste et subversif, sur le contexte géopolitique de la région. Pour explorer l’identité palestinienne, ces artistes évoquent les thèmes de l’exil, de la mémoire collective, de l’espoir du retour, de la fragmentation du territoire, de l’attente, de l’absence. Toutefois, il semble que certains archétypes se révèlent de manière plus saillante dans Bridge to Palestine et peuvent être emblématiques de l’évolution de l’art contemporain de Palestine aujourd’hui : « un art de la géographie fracturée », « un art de la violence revisitée » et « un art de l’existentialisme renouvelé ».
Un art de la géographie fracturée
Rafat Asad, vivant à Ramallah (Cisjordanie), annonce la couleur en recréant dans une installation vidéo Journey (2009), l’univers d’un aéroport factice : deux écrans affichant les départs et les arrivées des vols internationaux. Les vols de différentes villes du monde sont prévus « à l’heure » ou avec un « embarquement immédiat ». Mais ceux en provenance et au départ de Jérusalem, effectués par « Palestinian Airlines », sont inscrits « en attente » et « annulé ». Même à la fin des 15 minutes de vidéo, le vol Jérusalem est toujours dans l’attente. A l’aide d’un vocabulaire contemporain et minimaliste, c’est l’inaccessibilité d’Al-Quds qui est pointée. Rafat Asad souligne ici la distance symbolique qui le sépare de cette cité tant convoitée, malgré la proximité géographique, une vingtaine de kilomètres seulement séparant Jérusalem de Ramallah. Dans Journey, la rhétorique de la mobilité (ou plutôt de l’immobilité) est posée de manière directe, concise et efficace pour exprimer sa « dislocation personnelle et d’avec le lieu ». Rafat Asad qui a participé au dynamisme de la scène culturelle ramallaouie en cofondant en 2008, la galerie alternative Al-Mahatta, a su ainsi allier son fort ancrage local avec son expérience internationale. Pour l’heure, il ne peut toujours pas se rendre à Jérusalem…
Dans Journey, la rhétorique de la mobilité (ou plutôt de l’immobilité) est posée de manière directe, concise et efficace
La restriction aux libertés de mouvements est évoquée de manière plus implicite dans l’œuvre de Mary Tuma qui vit aux Etats-Unis. Elle met son apprentissage de la mode et de la broderie au service d’une œuvre déroutante, I am still here (2014). La pièce de « fiber art », qu’elle réalise en fils de laine enchevêtrés, se compose de deux pièces, laissant deviner la carte de Cisjordanie et celle de Gaza : manière poétique et délicate de dénoncer le morcellement perpétuel des Territoires palestiniens occupés. Affirmant un art « horror vacui », elle déconstruit l’espace avec précision et acharnement, pour reconstruire sa propre vision d’une identité symbolique et sa représentation d’une géographie fracturée.
Pouvant rappeler par certains aspects, les œuvres de Mona Hatoum qui a popularisé le motif iconographique de la carte, cette installation en diptyque – à la croisée de l’art et de l’artisanat – revisite de manière originale, une tradition artistique très ancrée en Palestine, le tatriz (« broderie »), d’abord issu du milieu rural et qui connaît une effervescence significative depuis la première moitié du XXe siècle.
Steve Sabella pousse, à l’extrême, l’esthétique de la fragmentation et lui confère une dimension à la fois physique et psychologique. Dans sa série de photomontages In Exile (2009), l’artiste originaire de Jérusalem, donne une forme visuelle à son exil, devenu permanent depuis qu’il s’est installé en 2007 entre Berlin et Londres. En jouant sur le même motif iconographique répété à l’infini – la fenêtre, symbole de la conscience – il propose des œuvres géométriques surchargées qui reflètent bien son état d’asphyxie intérieure. Depuis son départ de Jérusalem, il a pris l’habitude de regarder « tous les jours par la fenêtre » et de « décomposer la vue de sa fenêtre en la photographiant sous différents angles ».
En déconstruisant et réassemblant les fenêtres, il évoque les différentes facettes de l’identité palestinienne morcelée. Et lorsqu’il sent « que la nouvelle structure créée, reflète l’impossible réalité dans laquelle il vit », il cesse d’assembler les images. Ici, la question du rapport à l’espace est posée de manière plus conceptuelle. Les frontières territoriales se brouillent tout comme les frontières de l’être, et de l’identité en exil. A l’image d’un archéologue, l’artiste explore les différentes strates d’un esprit exilé dans une capitale occidentale. La référence à la Palestine étant subliminale, elle confère à l’œuvre, un caractère universel, pouvant refléter les sentiments de tout exilé dans le monde.
Ce sont les effets produits par la restriction à la circulation des biens qui sont illustrés par l’artiste gazaoui Mohammed Musallam. Dans la photographie Gaza au XXIe siècle (2008), l’artiste capture une ampoule accrochée au plafond, entourée de bougies. Mêlant avec efficacité, art conceptuel et minimalisme, il évoque les conséquences drastiques de l’embargo israélien sur Gaza, qui prive ses habitants des ressources primaires de base (ils ne bénéficient que de 6h à 16h d’électricité par jour en moyenne).
Pourtant, grâce au registre de l’humour, il se dégage de cette œuvre, une once d’optimisme. Son inspiration, Musallam la puise subtilement de son environnement local. Et comme bon nombre d’artistes de Gaza, il a pris l’habitude de recycler les matériaux de sa quotidienneté, pour en faire des installations habiles et concises, dans une tentative de contourner ainsi les effets dévastateurs de l’embargo économique sur sa région.
Nasser Soumi quant à lui, explore le paradigme de la géographie à travers la puissance évocatrice et symbolique de Jérusalem. Dans son imposante installation en bois To Jerusalem (2015), l’artiste joue avec le mouvement, à l’aide d’un train miniature télécommandé, posé sur un miroir sur lequel est inscrit « Beyrouth » d’un côté et « Jérusalem » de l’autre. Poétique et conceptuelle, cette œuvre évoque le trajet, désormais impossible, entre les deux capitales. L’artiste fait appel ici, à l’histoire du fameux chemin de fer du Hedjaz réalisé entre 1901 et 1908, qui reliait à l’époque, Damas à la Mecque, Jaffa à Jérusalem ou encore Gaza à Naplouse. Un temps bien révolu !
Dans le triptyque de peintures, Jérusalem, l’âme du lieu, fait de chaux, de cire de bois et de cendre, Soumi revisite un leitmotiv iconographique majeur : le Dôme du Rocher, objet de discorde entre Israël et la Palestine et capital symbolique fort dans la mémoire collective palestinienne. En alliant nostalgie et optimisme, passé et présent, ce passionné d’histoire des civilisations crée sa propre utopie d’une Jérusalem sublimée et confère à son œuvre une dimension mystique. Son art qu’il qualifie d’« instinctif » repose pourtant sur un long processus de recherches ; il est nomade et universel.
Le travail de Samira Badran explore de son côté, les thèmes de l’immobilité et du confinement liés à l’occupation israélienne. L’œuvre Siege (2005) dépeint une silhouette humaine sans visage, debout, campée dans un univers atemporel indéfini, hostile et inquiétant. Seules les prothèses de jambes sont identifiables dans les compositions saturées. Le choix du noir et blanc et la multiplication des lignes verticales en tension, allégorisent la notion de suffocation et d’aliénation. L’individu dépossédé de son visage et de ses jambes devient la marionnette du blocus. On lui a tout confisqué mais il marche quand même… Tout en revisitant par ses œuvres chargées de détails, l’imagerie de la prothèse en lui attribuant un sens de persévérance, Badran dénonce la violence structurelle propre à un pays sous siège. Il s’agit là, d’une réinterprétation visuelle du concept national palestinien, le sumud (résilience) d’un peuple qui continue à avancer, à résister, malgré les obstacles sur le terrain.
Un art de la violence revisitée
Leila Shawa, issue d’une famille influente de Gaza et actuellement basée à Londres , nous offre une œuvre emblématique avec sa sculpture Where Souls Dwell V (« Là où les âmes habitent V », 2013) – de la série Gun : une kalachnikov AK 47 – une des armes les plus produites au monde, symbole de l’industrie de guerre par excellence – est ornée de cristaux de Swarovski, de pierres de Rhin, de poudre d’or, de plumes et de papillons colorés. Réalisé un an après la guerre « Pilier de Défense » à Gaza (novembre 2012) pour l’exposition « The Peace One Day Project 2012 », réunissant des grands noms de l’art contemporain international (dont Damien Hirst et les frères Chapman), cette œuvre symbolique évoque les conséquences de la guerre : dans la mythologie grecque, le papillon est l’emblème des âmes des personnes défuntes.
 En détournant le sens initial de l’arme, elle en rend l’usage caduc pour mieux mettre en avant l’absurdité de la violence du monde contemporain. L’objet isolé, détourné de son sens originel nous introduit à un nouvel ordre, plus acéré et déroutant, de l’image. Cette admiratrice de Kokoshka, de Paul Klee et de l’artiste abstrait-décoratif Hundertwasser aime jouer avec les contrastes : préciosité du revêtement/violence du support; féminité/masculinité, beauté/cruauté; kitsch de la forme/sérieux du message ; lourdeur de l’arme/légèreté du papillon. Ce dispositif par antinomies est au service d’une œuvre de critique sociopolitique qui dénonce de manière subversive la cruauté de la guerre.
En détournant le sens initial de l’arme, elle en rend l’usage caduc pour mieux mettre en avant l’absurdité de la violence du monde contemporain. L’objet isolé, détourné de son sens originel nous introduit à un nouvel ordre, plus acéré et déroutant, de l’image. Cette admiratrice de Kokoshka, de Paul Klee et de l’artiste abstrait-décoratif Hundertwasser aime jouer avec les contrastes : préciosité du revêtement/violence du support; féminité/masculinité, beauté/cruauté; kitsch de la forme/sérieux du message ; lourdeur de l’arme/légèreté du papillon. Ce dispositif par antinomies est au service d’une œuvre de critique sociopolitique qui dénonce de manière subversive la cruauté de la guerre.
Sharif Waked résidant actuellement à Haifa, propose une video-art déconcertante, intitulée To be continued (2009). Au début, le spectateur est face à un prétendant au martyr, qui récite avec détermination, devant une caméra fixe, ce qui semble être des versets du Coran. L’iconographie des vidéos de martyrs est recréée dans sa totalité : kalachnikov au premier plan, fond vert et calligraphie arabe au second plan. Mais à y écouter de plus près, ce qui est déclamé, c’est le récit des Mille et une nuits. La vidéo de plus de 40 minutes se termine sans fin conclusive, transformant le moment de sacrifice en un état de perpétuel ajournement. Sharif Waked s’amuse à brouiller les pistes et combine les actualités d’un présent mouvementé, à des références au passé glorieux de la tradition musulmane. Il joue avec le contraste féminité/masculinité en attribuant des récits féminins à un homme et questionne l’image de la masculinité dans les sociétés arabes. Avec un humour grinçant, To be continued manipule ainsi l’esthétique des vidéos amateurs d’opérations-suicides et parvient à questionner l’absurdité des conflits contemporains. Mais surtout, il réussit à déconstruire, en manipulant les stéréotypes largement admis, l’image médiatique qui a longtemps assimilé le Palestinien à un terroriste.
Originaire d’un camp de réfugiés près de Bethléem, Monther Jawabreh prend la figure du mulattham (combattant) comme point de départ pour explorer la notion de résistance au sens large. Dans son triptyque photographique Phantom Series (2013), il montre un combattant vêtu de l’emblématique keffieh palestinien, devenu le symbole du nationalisme palestinien. Les yeux et le corps du combattant, qui ne porte pas d’armes, sont ici remplacés par des collages de papiers aux motifs fleuris. Comme évidé, le résistant est dépossédé de son aura.
- Monther Jawabri – Phantom Series
- Monther Jawabri – Phantom Series
- Monther Jawabri – Phantom Series
Utilisant le pop-art pour critiquer l’« iconisation » des héros de la lutte nationale et décontextualisant l’image conventionnelle du résistant, ce que Jawabreh entend revendiquer ici, c’est une résistance pacifique. Pour cet « artiviste » qui a cofondé plusieurs collectifs d’artistes en Cisjordanie (le dernier en date étant Marsam 301 à Bethléem), la résistance ne se limite pas à un acte politique, mais peut reposer sur la spiritualité et l’introspection. Aujourd’hui, chez la jeune génération et à l’heure de la désillusion généralisée issue de l’échec des Accords d’Oslo, ils sont nombreux à ne plus croire, comme lui, au héros collectif de la libération nationale, mais plutôt au héros individuel de la vie quotidienne.
Dans l’œuvre de Hisham Zreiq, le traitement de la violence est exprimé de manière explicite et crue, sans concession. A travers ses photomontages Refugee (2003) issus de la série War, l’artiste originaire de Nazareth résidant actuellement en Allemagne, part du thème des réfugiés – expérience vécue par son père qui a été chassé de son village en 1948 – pour explorer les notions d’exil, de souffrance et de mémoire collective. Il met ses compétences en art numérique apprises à l’université, au service de compositions symboliques et surréalistes, narratives et mystérieuses.
A travers des images filmiques, il retrace le récit du massacre et de l’expulsion des habitants d’Eilaboun, petit village palestinien de Galilée, lors de la Nakba. Armes de guerre, clé du retour des réfugiés, 1948 comme marqueur historique majeur pour la conscience palestinienne… en usant à foison d’éléments symboliques liés à la mémoire collective, Hisham Zreiq fait écho à l’iconographie moderne palestinienne.
Dans la série de photomontage de Guernica-Gaza (2010), l’artiste gazaoui Mohammed Hawajri interprète à sa manière, des peintures célèbres de l’art occidental, en y introduisant des éléments de son contexte local et quotidien. Dans cette œuvre tragi-comique, cet artiste autodidacte issu des camps de réfugiés de Gaza fait allusion à la guerre de 2008/9 à Gaza qu’il assimile au village espagnol de Guernica lors de l’attaque allemande en 1937 et dépeinte la meme année par Picasso. Ainsi, il replace la cause palestinienne dans une perspective plus globale. En alliant le familier à l’étranger, Mohammed al-Hawajri se fait là tout autant témoin-dénonciateur de la guerre qu’historien-ethnographe de son temps. Mais il ne se contente pas de dénoncer, il fait preuve aussi d’une ironie jubilatoire et d’une touche d’optimisme malgré tout. Il demeure convaincu que l’art par définition est « un art de résistance pour la liberté ». Hawajri est un des artistes les plus actifs de Gaza : il a cofondé, en 2002, un des premiers collectifs d’artistes indépendants à Gaza, Eltiqa Group for Contemporary Art mais comme la plupart des artistes de Gaza, si ses œuvres font le tour du monde, lui est la plupart du temps, assigné à résidence, faute de permis de sortie israélien, dans une bande de terre de 10 km de large et de 40 km de long.
Un art de l’existentialisme renouvelé
Dans l’œuvre d’art conceptuel Out of Frame (2012), Bashar Al Hroub révèle douze photos baignées d’un blanc immaculé où l’artiste se met en scène, derrière un voile faisant office de seconde peau ; seul le relief des mains et d’un visage est – à peine – perceptible. Dans cet univers froid et aseptisé, un personnage isolé, déshumanisé, sans expression, tente sans y parvenir de se débattre pour sortir de son enfermement et braver les frontières matérielles et symboliques qui l’emprisonnent.
A l’image de séquences filmiques fragmentées, cette série peut se lire comme une tentative désespérée d’échapper à une aliénation individuelle et collective. Cet artiste né à Jérusalem, qui vit actuellement à Ramallah, explore dans son œuvre les notions de liminalité et d’identité, tout en plaçant l’individu et le corps au cœur de sa réflexion artistique. Pour lui, il n’y a pas d’identité palestinienne, mais seulement de la nostalgie de l’identité palestinienne. Ainsi, son art, sorte de « quête existentielle », se tourne naturellement vers l’exploration de l’identité individuelle plus que collective.
Dans sa série en noir et blanc The Forgotten People (2004-5), Rania Matar place à son tour, l’individu au cœur de sa démarche artistique. Plus documentaire, plus explicite, s’emparant de la thématique des réfugiés, elle s’immisce à l’instar d’une anthropologue sur le terrain, dans les scènes de la vie quotidienne des camps libanais. Palestinienne du Liban expatriée aux États-Unis depuis 1984, cette photographe saisit des instantanés d’un « entre-soi » de l’enfance, au détour d’une ruelle dévastée d’un camp.
Admiratrice de l’œuvre d’Henri-Cartier Bresson, Costa Manos ou encore Joseph Koudelka, ses clichés révèlent des moments de loisirs et des scènes de la vie quotidienne, des visages expressifs, baignés d’espoir et de lumière qui semblent en décalage avec leur univers précaire. Tous ces instantanés sensibles, bercés d’un doux clair-obscur, lui permettent de montrer à travers le quotidien, l’intime de ces populations, leur humanité et leur volonté de vivre. Le regard perçant d’un enfant semble défier la caméra, comme il défie les conditions difficiles dans lesquelles il évolue. Dans un contexte particulièrement rude, la photographe parvient à débusquer l’invisible à l’écart de la temporalité de l’actualité des camps, à déceler l’indicible de ces vies ordinaires, tout en critiquant en filigrane une société chargée de paradoxes.
L’artiste Hazem Harb originaire de Gaza aujourd’hui en exil entre Rome et Dubaï, explore le thème de l’existence, à travers un point de vue très personnel et original. Dans sa série de peintures inédites – il s’agit de la collection privée de l’artiste – intitulée Invisibilité (2010), inspirée de l’art conceptuel et de l’expressionnisme, l’artiste dépeint des formes humaines stylisées : on devine çà et là une jambe, une main ou un visage désarticulé, décharné, à peine identifiable. Evoquant l’œuvre de Francis Bacon, des fragments de corps en mouvement se heurtent à des compositions géométriques dans lesquelles ils entrent violemment, comme par effraction. Doté d’une grande maîtrise technique (entre jets et aplats de peintures), l’artiste qui a entrepris ce projet à la suite de la guerre « Plomb Durci » de 2008 sur Gaza, rend les conséquences désastreuses de la guerre plus manifestes encore par la matérialité de la peinture. A l’instar de Goya ou de Picasso, c’est un art qui alerte, qui dénonce les horreurs de la guerre et la vulnérabilité humaine.
Jumana Husseini, « l’icône de Jérusalem » comme la nomme Nasser Soumi, nous invite quant à elle, à explorer la mémoire d’une Palestine de son enfance : « les toiles me permettent de retrouver la Palestine » dira-t-elle. Ayant vécu la plupart de sa vie en exil, elle quitte Jérusalem, pour Beyrouth en 1947, avant de faire ses études aux Beaux-Arts de Paris, ville où elle réside jusqu’à aujourd’hui. Née à Jérusalem dans une famille influente, elle restera toujours profondément attachée à sa ville natale qu’elle ne va cesser de dépeindre dans son art. On est tenté de lire dans ses
toiles abstraites et épurées (faites de cheveux, de parchemin et de papiers journaux), une évocation de ses souvenirs de Palestinienne en exil : « avant je peignais les scènes de Jérusalem, aujourd’hui je peins ce qui est sous-jacent à Jérusalem » à l’instar d’une historienne à la recherche de ses propres souvenirs. Ses toiles évoquent par certains égards, les œuvres de l’artiste américain Cy Twombly (1928-2011), connu pour ses œuvres explorant le dilemme abstraction/figuration, l’intervention de la psychanalyse ou le rôle de l’écriture en peinture. Dans des atmosphères nébuleuses, aériennes voire spirituelles, Jumana Husseini immisce du texte, tradition majeure dans l’art contemporain arabe. Depuis la Première Intifada, elle s’est tournée vers l’abstraction pour exprimer sa mémoire individuelle et a placé l’humain et sa subjectivité, au cœur de ses recherches artistiques.
Aissa Deebi, artiste plasticien et chercheur basé entre New York et Genève, propose une vidéo théâtralisée, The Trial, qui recrée un événement de l’histoire nationale palestinienne : le procès en 1973 du révolutionnaire et poète arabe israélien Daoud Turki (1927-2009). Cette figure marxiste, leader du parti de gauche arabo-juif, « le Front Rouge », avait proclamé sa solidarité avec « tous les travailleurs, les paysans et les personnes persécutés de la société israélienne », critiquant ainsi le sionisme responsable d’opposer les Juifs aux Arabes. Il avait été condamné à 17 ans de prison pour « trahison » de l’État d’Israël. En tirant directement son titre du roman Le Procès de Franz Kafka, Deebi souhaite mettre en évidence la même absurdité dans le cas de Turki à Haifa que dans celui de Joseph K. à Prague. Dans les deux cas, il n’y a pas de moyen de sortie : comme le récit, le film semble inachevé, sans fin déterminée. Avec The Trial, Aissa Deebi entend donner à son œuvre un caractère existentialiste à travers des thématiques bien particulières : l’absurdité du monde, la contingence de l’existence ou l’oppression politique, tout en critiquant le système judiciaire corrompu et les totalitarismes des mondes contemporains. Basée sur un travail d’archives, cette œuvre ouvertement politique, s’efforce en filigrane, d’imaginer une nation à distance, au moment même où le champ politique semble passablement verrouillé. Dans ce contexte de désillusions et de dispersion, l’espace de l’art serait-il un des derniers endroits où l’individu opprimé pourrait conserver une lueur d’espoir ?



















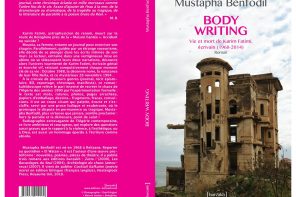





Un commentaire