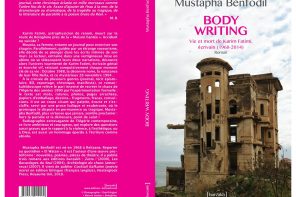Dans son dernier film L’institutrice, Nadav Lapid nous livre une vision tout en noirceur de la société israélienne. Derrière la modernité de notre époque, Lapid aborde le dérèglement d’un monde consumériste et sans limites.
Nadav Lapid, ce touche-à-tout de 39 ans, écrivain avec son roman Danse encore en 2011 et réalisateur avec son premier long-métrage Le policier, gagnant du prix du jury au Festival de Locarno, revient bousculer le cinéma avec L’institutrice et nous montre l’anormalité d’Israël. A prime abord, une histoire banale. Celle d’une institutrice qui découvre le don de l’un de ses élèves.
Un scénario déjà abordé plus d’une fois, certes, mais cet enfant a quelque chose de surprenant. C’est un poète en herbe qui n’est encore qu’au jardin d’enfants. L’institutrice Nira est une idéaliste, mais Lapid va user du personnage pour mettre en exergue bien plus que des poèmes. Il montre de manière brutale un pays à la psychologie détraquée, une société commerciale, empreinte de violence et de tensions ethniques. Cette folie transparaît d’abord dans le caractère de la douce Nira, aux traits doux et au visage triste, incarnée par l’actrice Sarit Larry. Fascinée par le don de l’enfant poète Yoav et tentant d’échapper à la banalité de sa vie conjugale, elle est de plus en plus subjuguée par le prodige des mots. Presque amoureuse de ce jeune poète au point de devenir obsédée en permanence par l’enfant qui ne laisse rien paraître de son mystère. Elle va tenter de le soustraire au monde extérieur afin de développer son insolite talent. Nira se sent investit d’une véritable mission de sauvetage du génie de Yoav.
Sur fond de cette rencontre, le réalisateur évoque plusieurs traits de l’Israël moderne. Notamment à travers des problèmes communs aux Israéliens mais aussi aux sociétés qui abritent plusieurs ethnies et cultures, ici le cas des Ashkénazes et les Séfarades. Des différences qui sont source d’un conflit interne entre une élite et une population majoritairement orientale.
Nira explique qu’elle est séfarade et issue d’une famille pauvre. Elle a vécu une enfance difficile, sans livres autres que religieux. Bien que moins forte que par le passé, la division peut encore se faire sentir et l’institutrice tente d’éclaircir cette scission historique au jeune poète. Une scène qui permet de voir qu’en dehors du conflit entre Israéliens et Palestiniens, la société israélienne dans sa composante juive est travaillée par de multiples conflits internes. Si le réalisateur n’aborde pas les difficultés d’intégration des communautés russes, éthiopiennes et arabes, il effleure du doigt la facette mosaïque de l’état hébreu.
Un portrait peu reluisant
L’institutrice est en fait un reflet d’une transformation profonde d’une société israélienne de plus en plus matérialiste, vulgaire, populaire et populiste dans tous les sens. Mais cette société semble n’être qu’un des nombreux exemples de notre époque mondialisée, une tendance planétaire. Une économie en expansion, une société qui bouge rapidement, brutalement, d’autant plus vite que le pays est jeune par son histoire et sa population, il existe moins de pesanteurs pour s’opposer à ces évolutions que dans des états comme les vieilles nations européennes.
Bien qu’ayant une personnalité quelconque aux premiers abords, Nira se veut la prophétesse de Yoav, celle qui croit à un idéal. Une radicalité tranchante dans une époque de relativisation des idéologies. Elle représente une face sauvage, extrême, entière de notre société, une révolutionnaire pure, passionnée de justice capable d’enfreindre les règles pour un but supérieur. Croire encore aux pouvoirs et à la beauté de la poésie au XXIe siècle, quoi de plus révolutionnaire ?