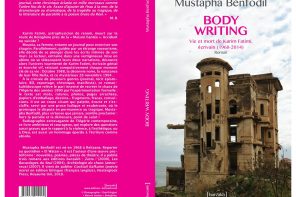La Belle et la Meute (Aala Kaf Ifrit) est le premier film de fiction de Kaouther Ben Hania, connue auparavant pour ses documentaires avec Le Challat de Tunis (2014) ou Zainab n’aime pas la neige (2016).
L’équipe de La Belle et la Meute s’est fait remarquer il y a quelques mois au Festival de Cannes 2017 dans la section dérivée de la sélection officielle, « Un Certain Regard ». Et c’est bien notre regard que nous avons dû soutenir. Non, sans détourner une seule fois les yeux pendant cette heure et demie décapante.
Les Douze Travaux d’Hercule (ou d’Astérix) semblent tellement faciles après avoir vu La Belle et la Meute. Forcément, la réalisatrice n’y va pas avec le dos de la cuillère, sa mise en scène nous invite à parcourir neuf plans séquences bien déterminés, tournés caméra à l’épaule, où les genres du drame, de l’horreur, de l’action et du mélo s’entrechoquent violemment au sein d’un réalisme déconcertant.
L’adjectif « violent », ainsi que le verbe « violer » nous vient du latin « vis », qui désigne d’abord « la force en action »
Car oui la violence est le leitmotiv de ce film. Une violence qui commence doucereuse avec la robe déchirée de la Belle — Mariam (Mariam al-Ferjani) jusqu’à la conquête du Beau — Youssef (Ghanem Zrelli) qui ne sera pas ici le prince, encore moins la Bête de sa belle, mais son guide pendant une bonne partie des tourmentes qui suivront, ces dernières allant en crescendo.
Après l’ambiance feutrée de la soirée étudiante, nous sommes soudainement projetés dans l’espace urbain noir de Tunis, éclairé par l’écho électrique des lumières publiques. Au loin, la jeune Mariam court vers nous, en pleurs et sous le choc, suivie de près par un Youssef bienveillant. Une scène est manquante et le restera pour toujours. C’est lorsque nous arrivons dans un hall de néons blancs glacials de la Clinique des Rosiers que nous allons comprendre que notre Belle s’est fait violée et qu’elle cherche à obtenir un certificat pour revendiquer ses droits. C’est à partir de ce premier échange insensé avec la réceptionniste qui refuse de la prendre en charge sans ses papiers, égarés, que va s’enchaîner pendant toute la durée du film d’étranges quiproquos faisant de tristes imbroglios qui banalisent progressivement le viol de Mariam.
Un système kafkaesque…
La mise en scène du film va de ce fait enfermer progressivement le personnage dans la tourmente allant jusqu’à la faire hésiter sur la plainte qu’elle voudrait déposer ou lui faire dire une version qui ne se serait pas passée. Aucun personnage, pas même Youssef finalement, n’est réellement bouleversé par l’événement et chacun va réagir à sa façon, jouant un rôle bien défini. Youssef en premier, représente la figure militante souhaitant faire valoir les droits de la victime pour continuer son combat contre le système tunisien. Il est rejoint plus loin par un des policiers, plus âgé et désarmé par le monde qui l’entoure, en sauvant la partie de Mariam d’une échauffourée. Les agents administratifs présents dans le film sont des éléments qui vont chercher à semer des embûches le long de la via dolorosa de notre héroïne.
Digne du Château de Kafka, La Belle et la Meute insiste sur le fait que le problème du système législatif tunisien n’est pas d’être mal agencé mais qu’il s’agit juste de tenir bon pour faire appliquer les lois et avoir justice. D’un côté la procédure n’est pas dans les normes, ou alors la personne n’est pas habilitée à lui accorder ce qu’elle veut. Chaque pion la ralentit, la décrédibilise tout en lui cherchant l’échec et mat.
… où la violence y est légitime
Les parades pourraient être plus faciles mais nous oublions d’évoquer la police et ses agents, l’institution la plus importante dans cette histoire. En effet, faire valoir ses droits lors d’un viol nécessite d’acter un procès verbal au sein d’un commissariat de police, permettant d’aller ensuite se faire ausculter par un médecin légiste qui va reconnaître la nature de l’acte pour in fine déposer plainte et entamer une procédure judiciaire contre l’agresseur.
Comment faire lorsque les violeurs sont des policiers, que la victime doit aller dans le poste où le crime s’est déroulé, et potentiellement être confrontée à ces derniers ? Une situation piquante, doublement tabou lorsqu’il s’agit de faire reconnaître d’un côté le viol et de l’autre, l’impunité de la police. Le film agence constamment un schéma où la culpabilisation et la violence masquée (celle dont nous avons l’habitude) sont quasi omniprésentes. Si Mariam, seule contre tous, déjoue plus ou moins les éléments perturbateurs, comment arrivera-t-elle à remonter les limbes de son enfer ? Humiliée, discréditée, intimidée, harcelée, moquée ou ignorée, Mariam Chaouch, 21 ans, n’a pas l’étoffe d’une héroïne mais adoptera finalement et malgré elle la carte de la résistance.
La fin du film nous annonce que Kaouther Ben Hania s’est inspirée d’une histoire vraie, celle de Meriem ben Mohamed qui a relaté ses événements dans un ouvrage intitulé Coupable d’avoir été violée (2013) et dont les ravisseurs ont été incarcérés à la suite d’interminables mises en justice.