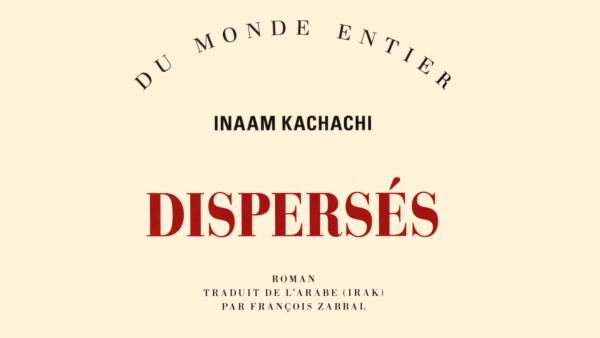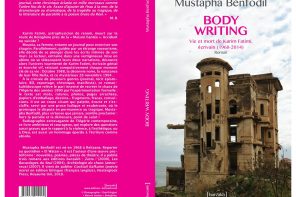Depuis la chute de Bagdad, il nous est rarement donné l’occasion d’entendre la plainte de la victime principale : le peuple irakien. Nous savons qu’il existe mais l’écran devant lequel nous nous tenons ne le personnifie jamais. Nous savons simplement que loin là-bas, il existe des gens qui crèvent à la pelle.
Rares sont également les œuvres littéraires ou artistiques qui offrent au lésé le droit de témoigner de son préjudice. Les artistes irakiens locaux sont engloutis par un quotidien infâme et sont incapables de porter leur voix tandis que l’exilé s’arrache pour se reconstruire. Reste cependant ceux qui ont quitté le pays quelques années auparavant. Inaam Kachachi, romancière irakienne, fait partie de ceux qui ont échappé, du moins physiquement, au désastre irakien pour mieux en parler. Parler de qui ? De ceux qui se sont Dispersés, c’est le titre de son roman paru cette année chez Gallimard. Après avoir terminé, non sans douleurs et larmes, ce qui était ma propre histoire, j’ai eu l’honneur de pouvoir rencontrer l’auteur et parler de notre tragédie.
Bagdad, capitale des abbassides, foyer artistique, centre culturel du monde arabe, voilà une ville souvent chantée et exaltée par les poètes pour sa gloire alors que d’autres s’en rappellent avec amertume et tristesse du fait des guerres et des invasions qui la ravagent. Est-ce donc le destin des habitants des deux rives d’être Dispersés pour reprendre le titre de votre roman ?
Inaam Kachachi : Si la guerre était réellement le destin des habitants de la Mésopotamie, alors je ne vois pas de destin aussi sombre que celui qui a touché ses habitants ! Tous ces événements que nous avons vécus laissent l’impression d’une malédiction. Cette dernière dure bien longtemps et a fauché plusieurs générations. Toute l’histoire de la Mésopotamie est jonchée par des invasions, mais l’invasion américaine de 2003 fait partie de celles qui ont tout détruit sur leur passage.
Telle est la raison pour laquelle je suis devenue romancière. J’ai senti une gomme qui se précipitait sur l’Irak que j’ai connu et qui allait tout effacer. Ecrire devenait une nécessité. Plus qu’un reportage ou un article, il me fallait quelque chose de plus vaste. Le roman est alors devenu le moyen par lequel je m’adresse aux nouvelles générations en leur disant : tel est l’Irak que nous avons connu.
Pour parler de cet Irak qui se dispersait, je me suis retournée vers mes anciens blocs-notes où les notes prises lors des interviews étaient gardées en entier. Le métier de journaliste vous oblige à tirer, sélectionner et mettre de côté des écrits qui, plus tard, vous inspirent des personnages. Me sont alors revenus les hommes et femmes que j’avais rencontrés pendant mon métier, des personnages naissaient et marchaient sur mes cahiers en me demandant le droit de vivre et de témoigner.
Parmi ceux qui se sont dispersés, figure « doktora » Wardiya Iskandar, votre personnage principal, brillante gynécologue de quatre-vingts ans, elle a passé toute sa carrière au service des familles irakiennes, malgré tous les aléas de la vie politique agitée de l’Irak. Au fur et à mesure que nous progressons dans sa biographie, la situation de l’Irak se dégrade jusqu’à l’invasion américaine qui va contraindre Wardiya à l’exil. Que signifie pour vous le départ de Wardiya de l’Irak ?
I.K : L’Irak s’est exilé de lui-même ! Telle est l’histoire. L’invasion américaine a dispersé les Irakiens comme le coup de fusil qui fait s’envoler les oiseaux. Wardiya a quitté très jeune sa famille pour travailler à l’hôpital de Diwanya au sud de l’Irak. Jeune médecin, elle a vécu paisiblement et librement dans une ville à majorité chiite. A aucun moment on lui a demandé sa confession. Elle a servi ses concitoyens durant soixante ans et au gré des coups d’Etat et des renversements de régime. Après la chute de Bagdad, la situation devient si dangereuse qu’elle ne peut plus assurer sa sécurité. Elle part donc se réfugier auprès de sa nièce en France.
Quatre ans après la parution de mon livre en arabe : je reçois énormément de lettres et de mails de la part de lecteurs irakiens qui me disent : « Comment avez-vous fait pour décrire notre vie ? L’histoire de Wardiya est notre histoire ». Ces réactions me surprenaient : tous ces irakiens dispersés se retrouvent dans la vie d’une irakienne de quatre-vingt ans de confession chrétienne! En y réfléchissant, ce n’est pas aussi surprenant que cela puisse paraître. La personnalité irakienne avait cette rare capacité de cohabitation. Ainsi quel que soit la confession du lecteur, il a réussi à se reconnaître dans cette biographie.
Mais tout ceci a disparu… La société irakienne est tombée dans l’escarcelle du confessionnalisme politique. Aujourd’hui, je lis des commentaires insupportables sur Facebook à propos de mon livre ; un internaute écrivait dernièrement : « J’ai bien aimé ce livre mais je regrette qu’il n’y ait pas de personnage sunnite ». Puis dans une dernière conférence, on m’interpellait sur le fait qu’il n’ait pas de personnages communistes… Or, je ne cesse de répéter que l’œuvre littéraire n’est pas un recensement. C’est une catastrophe et le plus désolant c’est que ce sont bien souvent les jeunes, ceux qui sont censés construire l’Irak de demain… Maintenant, lorsque j’écris un roman, je dois à chaque page penser à ce que telle communauté ne soit pas heurtée par tel propos. Le choix des noms devient un casse-tête ! C’est une prison pour l’auteur !
Depuis, et de manière plus tragique, le sol irakien ne cesse de recenser les morts, des fils qu’on a kidnappés et qu’on n’a plus retrouvés, des corps longeant les rues que découvrent les enfants en rentrant de l’école. Votre personnage Souhayla n’y échappe pas…
I.K : De telles anecdotes les irakiens en ont vu des milliers… Comme bien de mères irakiennes, Souhayla a vu son fils Raad partir et ne jamais revenir. Elle apprend qu’il est kidnappé et que les ravisseurs demandent une rançon qu’elle arrive tant bien que mal à payer. Hélas, son fils ne reviendra jamais… Des proches lui apprenant quelques semaines plus tard qu’ils ont vu la photographie de son fils sur la liste des corps anonymes de la morgue d’un hôpital de Bagdad.
Tel était le quotidien en Irak : chaque jour, on trouvait au bord de la route des centaines de cadavres. Avant d’être enterrés, les défunts anonymes se font photographier afin que plus tard, leurs familles puissent reconnaître le corps. Comme personne ne l’avait reconnu, le corps de Raad avait été transporté à Najaf, le plus grand cimetière chiite au sud de l’Irak. Souhayla part alors à la recherche du corps de son fils pour le transférer et l’enterrer près de son père, martyr de la guerre Iran-Irak.
La réalité dépasse la fiction en Irak. L’écrivain irakien n’a pas besoin de ce que la littérature d’Amérique latine appelle la réalité fantastique, puisqu’en Irak, il la vit tous les jours!
Pourtant, l’Irak d’antan, comme la ville de Mossoul où naît et grandit Wardiya, apparaît comme une mosaïque de cultures, de religions et d’ethnies. L’anecdote du prix que reçoit le frère de Wardiya en guise de récompense pour sa réussite en langue arabe illustre cela. Que symbolise cette anecdote pour vous ?
I.K : Pour tout vous dire, cette anecdote fut réellement vécue par mon père. En 1937, il terminait ses études secondaires et arrivait le premier dans toute la province de Mossoul en langue arabe. La tradition voulait qu’on remette au vainqueur un Coran comme prix en guise de récompense. Alors, à la sortie du lycée, mon père est emmené par le proviseur dans la grande libraire locale. A la surprise de mon père, le proviseur lui offre de choisir le livre qu’il veut, quel qu’en soit le prix… Mon père refuse en disant qu’il souhaite être récompensé comme tous les autres étudiants avant lui ! Le proviseur lui répond alors : « Mon garçon ! Tu es chrétien et Mossoul est une ville conservatrice », ce à quoi mon père réplique « Je n’accepterai que le Coran!« . Le proviseur en fut ému et mon père obtint alors gain de cause. Par la suite, il jura que ce livre serait honoré, aimé et protégé au sein de sa famille et ce plus que dans n’importe quelle autre famille !
Ainsi donc, jeunes, nous avons étudié et aimé la langue arabe grâce à ce Coran. Notre passe-temps en famille consistait à nous réunir pour parler de littérature et de poésie. Lorsque divergence il y avait autour d’un mot ou d’une voyelle, on se tournait vers le Coran et on invoquait telle sourate pour justifier notre choix grammatical. Depuis, le Coran a toujours trôné en haut de notre bibliothèque.
Avec la publication en français de votre roman et la sortie dans les salles du documentaire d’Abbas Fadhel, le public français a pu accéder à deux œuvres littéraires et artistiques où les auteurs irakiens pouvaient enfin témoigner de la tragédie irakienne. Jadis, seul le point de vue américain pouvait être perceptible par le public. Est-ce le signe d’un changement ?
I.K : Les médias ont malheureusement toujours résumé l’Irak à un pays de conflits, sous dictature, détenant des armes de destruction massive, etc. Toute une société civile, active, cultivée, se trouvait occultée par ces conflits. Par ailleurs, la médiatisation des victimes au Moyen-Orient est très problématique. L’Orient est représenté d’une manière bien particulière : tout est en pluriel et de manière anonyme! On est tué à la pelle, bombardé à la pelle ! On nous dit que cent personnes sont mortes dans un attentat à la voiture piégée. Mais qui sont-ils ? Ont-ils des noms ? Ont-ils des visages ? Ailleurs, les victimes ont droit à un portrait, une histoire, des rivières de bougies et de fleurs…
Beaucoup d’artistes irakiennes et irakien vivant à l’étranger prennent aujourd’hui la parole en public pour témoigner de leur indignation face au sort réservé au peuple irakien. Abbas Fadhel que j’ai connu alors qu’il n’était qu’un jeune étudiant en cinéma, fait partie ces personnes courageuses qui participent à ce mouvement.
Les préjugés d’autrefois sont-ils donc définitivement dépassés ?
I.K : Ce n’est pas tout à fait le cas. Nous devons toujours faire face à certaines questions qui nous agacent… On vous posera toujours la question de savoir si vous êtes sunnite ou chiite… Ah que cette question me tue ! Est-ce qu’on peut demander à un intellectuel ou à un journaliste français : « êtes-vous catholique ou juif ? » C’est une question qui n’a pas de pertinence ! Pourquoi voulez-vous m’emprisonner dans ma religion ? Je ne suis pas Inaam Kachachi de telle confession ou de telle religion ! Je suis Irakienne, point final ! D’ailleurs, s’ils savaient que je ne suis ni sunnite, ni chiite… Alors là, on entrerait dans d’autres considérations, d’autres labyrinthes… C’est pourquoi j’essaie de ne pas en dire plus et je refuse de répondre à ces questions honteuses.
Par ailleurs, je peine toujours à faire comprendre à mon interlocuteur que je n’étais ni exilée, ni réfugiée. Je refuse cette étiquette. Je n’étais ni victime d’abus, ni de viol, ni de harcèlement! Et je n’ai été ni emprisonnée, ni battue, ni lapidée! Ma vie fut celle d’une femme moderne venant de la classe moyenne irakienne. En Irak, j’ai effectué mes études à l’université où j’ai pu rencontrer celui qui est devenu mon mari. Nos études nous ont emmené à voyager et nous avons décidé de venir vivre en France et d’y étudier. Or, pour les médias, si vous n’avez pas une histoire de persécuté, vous n’êtes pas intéressant ! Vous devez porter la trace de votre persécution sur le bras pour être bankable. Derrière se trouve le préjugé orientaliste – présent dans l’art contemporain – de la femme orientale esclave, jetée dans les bordels avec le narguilé dans les mains. Les librairies étrangères sont pleines de femmes « écrivaines » livrant des histoires sournoises.
—
Début septembre, le 4ème Prix de la Littérature arabe, créé par l’Institut du monde arabe et la Fondation Jean-Luc Lagardère, a été décerné à Inaam Kachachi pour son roman Dispersés, publié aux éditions Gallimard, et traduit par François Zabbal.