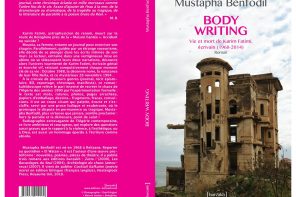Née au Liban en 1977, en pleine guerre civile, Rita Bassil quitte Beyrouth en 1996 pour la France, où elle réside jusqu’en 2016. Après un doctorat en Littérature Générale et Comparée à Paris III, elle publie des chroniques et des entretiens dans la presse libanaise et française (Revue Esprit, Orient XXI).
Dès ses débuts, elle double sa pratique du journalisme avec une activité de poète. Elle a publié à ce jour deux recueils (Beyrouth ou le Masque d’Or, Beyrouth, Dar an-Nahar, 2003 ; L’Eau se brise en éclats, Beyrouth, Dar an-Nahar, 2008) et prépare un roman. Mounir Abou Debs, à l’ombre du théâtre est son premier film. Il est projeté le 20 septembre prochain au cours de la 13e édition du Lebanese Film Festival à Beyrouth. Retour avec elle sur l’aventure d’une rencontre, et sur le portrait de ce grand homme de théâtre récemment disparu.
Rencontre avec Rita Bassil.
Comment présenteriez-vous Mounir Abou Debs ?
Mounir Abou Debs est avant tout un poète – mais un poète dont le rôle dépasse la linguistique. Il déborde la position du poète telle que je la conçois, dont le rôle est celui de transmettre la parole poétique, comme le fait le poète de la Cité ou la tribu dans la tradition gréco-latine et arabe. Mounir sans cesse me perturbe dans mes propres définitions des choses. Si le poète est, comme je le dis, le porte-parole de la Cité et de la tribu, donc de la société, Mounir a toujours refusé –radicalement- la consommation de la parole poétique. Ce n’est pas la guerre qui constitue le point de rupture entre la scène libanaise et lui mais la consommation. Mounir a offert au Liban les piliers du théâtre contemporain : parmi ses premiers élèves figurent Antoine Kerbaj (le seul acteur des opérettes des frères Rahbani qui ne chantent pas et sur qui repose toute la trame), Mireille Maalouf, Antoine Moulta’a, Latifé Moulta’a, Raymond Gebra… Adonis traduisait pour lui le théâtre classique et Unsi el Hajj le théâtre contemporain (Ionesco, Holderlin…). À Baalbeck, il a été le directeur scénique des Rahbani, de Nooriev, Béjart, Um Kelthoum.
La question du rapport de Mounir à la guerre est encore un autre sujet qui recoupe cependant le nôtre. Mounir a résisté à la guerre dans ses travaux. Il a empêché la guerre de pénétrer son espace scénique. Seule Ishtar, jouée à l’Odéon en 1977, deux ans après le déclenchement du conflit au Liban, évoque ce qu’il désigne comme « l’état de violence et de bêtise ». Toute sa fascination pour Sophocle tourne autour de la consommation, et sa radicalité envers la consommation de la violence. Dès les débuts de son travail au Liban (rappelons qu’il a été le fondateur de la première école de théâtre au Liban grâce au soutien du Festival International de Baalbek et le fondateur du département dramaturgique de la première chaîne de télévision au Liban « Télé Liban »), il a décidé de masquer ses actrices et acteurs. Le sculpteur allemand, Alphonse Philips, fabriquaient les masques. Il ne fallait aucune trace de violence. Les acteurs, comme aux temps de Sophocle, changeaient de masque pour exprimer les mutilations (comme dans le cas d’Œdipe, par exemple). Le masque est l’essence même de la présence de l’acteur sur scène, qui est en elle-même un état d’absence que l’acteur doit atteindre en gommant tout ce qui charge de l’extérieur le persona, et qui va l’aider à se déshabiller de soi-même pour habiter un autre qui devient soi lors de l’identification.
Comment avez-vous croisé son chemin ?
Ma rencontre avec Mounir fut une « tempête » générée dans le cadre d’un festival belge de poésie nomade « Maelstrom ». Je faisais partie alors des poètes invités au Liban par le festival. J’ai lu un soir ma poésie dans ce lieu sublime, un vrai temple de la beauté. C’était une ancienne magnanerie à Freiké sur une montagne surplombant une vallée dans le Mont Liban, un lieu à l’image de Mounir, à l’écart du monde dont le seul accès, qui se fait par une allée de pins, nous impose le silence et le retrait du monde – ce que la poésie est. Nous avons depuis cet instant conversé des heures durant et nos rencontres pouvaient s’étendre des heures. Lorsque je suis revenue à Paris où je résidais encore, j’ai décidé de faire un documentaire sur Mounir bien que n’aie jamais étudié la réalisation de films. Mon envie soudain devenait intensément évidente. Je suis allée ainsi de l’écriture à l’image.
On devine dans le film une grande complicité entre vous et ce metteur en scène. Que représente Mounir Abou Debs pour vous ?
Nous avons passé de magnifiques moments avant et pendant le tournage. Nous n’avons jamais senti la présence de la caméra. Majid Kassir et Jacques Bouquin qui ont filmé l’un au Liban et l’autre à Paris étaient totalement intégrés à nos entretiens qui ne nous semblaient jamais « regardés ». Cette complicité a contaminé toute l’équipe, Youssef Khoueiry qui a fait le montage et Ali Zreik qui a fait la bande-annonce et l’affiche du film.
Mounir a joué un rôle quasi psychanalytique dans ma vie, sans le savoir. Je suis née en 1977, en pleine guerre civile et sur l’ancienne ligne de démarcation. Comme la guerre a précédé ma naissance je n’ai jamais pu me débarrasser de cette « évidence » de la guerre qu’on retrouve dans tous mes écrits. Je n’ai jamais pu m’en débarrasser parce qu’elle fait partie de moi. Mounir a connu le Liban avant sa destruction, alors que le pays était en plein essor. Il a fondé son école de théâtre à la fin des années 1950 dans le cadre du Festival de Baalbek, le premier festival du Liban créé par un président de la République. Cette époque semble impossible à imaginer de nos jours. Toucher à Mounir signifiait pour moi me défaire de la guerre, de la monstruosité dans laquelle je suis née et qui me dépossède de ce pays que je n’ai pas envie de nommer « natal », même s’il l’est bien sûr. Je le rejette parce que l’idée de frontière me paraît de plus en plus asphyxiante, criminelle et bête. Un pays, de même que ses habitants, concernent toute la planète – surtout quand on donne son avis et qu’on vend des armes, ou bien qu’on exploite sa main d’œuvre ou qu’on la colonise… Cela ne veut pas dire que Mounir n’a pas souffert intensément de la guerre qu’il a refusée de vivre en fuyant en France, son deuxième pays, même s’il ne l’évoque jamais. On m’a reproché de ne pas donner plus d’espace à la guerre dans mon documentaire. Justement, je ne pouvais pas la laisser faire du bruit et trahir Mounir qui s’entourait d’arbres pour dissimuler à ses yeux la laideur du monde.
Vous êtes poète et journaliste. Mounir Abou Debs est votre premier film. Pensez-vous poursuivre une carrière cinématographique après celui-ci ?
Je pense que je dois attendre les suggestions de la vie, les exigences des rencontres et l’effet qu’elles feront sur moi. Mais il est vrai que l’image empiète de plus en plus sur la parole lorsque je réfléchis. On m’a toujours dit que mes poèmes étaient visuels. J’admets que j’ai de plus en plus envie de créer un format qui se situerait entre la parole et l’image.
Quels sont vos projets ?
Je vis depuis quelques années avec un manuscrit presque prêt. Un roman, cette fois. Maintenant que le film est terminé et que je peux laisser Mounir sans moi avec le public, je dois m’occuper de mon roman. C’est un roman-image. À la croisée de ces deux mondes.
Mounir Abou Debs, à l’ombre du théâtre, un film documentaire écrit et réalisé par Rita Bassil, durée : 37 minutes, montage : Youssef El Khoueiry, image : Magid Kassir, Jacques Bouquin, graphisme : Ali Zreik.
Projection le 20 Septembre 2018 à 20h15 au Beirut Souks Cinemacity
Lebanese Film Festival.